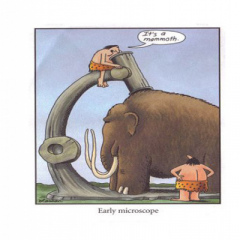-
Contenu similaire
-
Par transitmk1
un petit tour dans les pieds de la grande ourse pour capturé M109 et ces voisines ,avec 50 brutes de 3mn ,avec lunette 102mm,asiaireplus, asi2600,traitement siril et astrosurface
-
Par Nicolobrica
Je vous propose ici quelques images de saison réalisées autour de la précédente nouvelle Lune, avec plusieurs nuits dégagées mais un seeing assez variable.
Le matériel utilisé est le T200 ramené à 600mm de focale via un correcteur/réducteur Starizona Nexus, avec la nouvelle QHY Minicam 8M, le tout sur une AZ6GT guidée.
Comme toujours, les cumuls sont assez faibles, mais la Minicam est hyper sensible et mariée ici à un tube à F3 les photons s'accumulent vite!
En avant pour les images:
Nous sommes dans la constellation du Petit Lion, et c'est la galaxie spirale NGC 3344 vue de face qui trône au centre de l'image. Très jolie galaxie avec une zone centrale assez lumineuse mais des extensions très faibles. On voit des galaxies lointaines situées à l’arrière plan sur la bordure droite de la galaxie.
NGC 3344 (Lmi) - 20x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Constellation de la Vierge, avec ce sympathique duo NGC 4536 / 4527. La première, a droite, est une spirale intermédiaire peu lumineuse (magnitude surfacique de 14.06), la seconde appartient à la même catégorie et est un peu plus contrastée. Elles se situent toutes les deux a environ 45 millions d'a.l.
NGC 4536 et 4527 (Vir) - 20x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Voici un morceau de la célèbre chaine de Markarian, un chapelet de galaxies situé dans la constellation de la Vierge. Dans l'ordre de taille apparente, nous avons ici la galaxie elliptique M86, puis Le duo NGC 4438/4435 qu'on apelle aussi "les yeux (ne me demandez pas pourquoi)n viennent ensuite NGC 4388, NGC 4402, NGC 4425, NGC 4413 et enfin NGC 4387, plus une multitude d'autres galaxies plus lointaines. Le seeing n'était pas extraordinaire à cette hauteur cette nuit la hélas.
M86 & co (Vir) - 20x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full résolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Un petit groupe de galaxies dans la Chevelure de Berenice, constellation qui fourmille de ce genre d'endroits!
NGC 4090 & co (Com) - 20x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Constellation de la Vierge, avec à droite NGC 4517 (aussi cataloguée NGC 4437) et à gauche NGC 4517A. NGC 4517/4437 est une galaxie spirale vue par la tranche, elle se situe a environ 30 millions d'années lumière et fait un peu moins de 100000 a.l. pour une magnitude de surface de 13.39. Sa petite voisine NGC 4517A, aussi connue sous le nom de Reinmuth 80 est une spirale assez faible qui se situe a environ 40 millions d'a.l.
NGC 4517/4437 et 4517A (Vir) - 20x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
M101 et NGC 5474, dans la Grande Ourse.
M101 et NGC 5474 (Uma) - 30x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Constellation du Dragon, NGC 5987. NGC 5987 est une grande galaxie spirale de 216000 a.l. qui se situe à environ 147 millions d'a.l. Sa magnitude de surface est de 13.54 et seul son noyau est relativement lumineux. Sa principale originalité ce sont ses bandes de poussières à la disposition originale.
NGC 5987 (Dra)- 30x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Voici ACO 1656, un amas de galaxies dans la Chevelure de Berenice. L'image ici n'embrasse qu'une partie de l'amas, qui contient plus de 1000 galaxies, principalement des galaxies naines et des elliptiques géantes, mais on trouve aussi des lenticulaires et des spirales. La distance moyenne de cet amas est de 323 millions d'années lumière. C'est un coin du ciel assez vertigineux qu'on ne se lasse pas d'observer, et qui incite a la réflexion...
ACO 1656 (Com)- 40x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Le groupe compact Hickson 61. Cette scène pittoresque est située dans la constellation de Coma Berenice. Au centre se trouve le groupe de galaxies Hickson 61, connu sous le nom de « The Box » en raison de sa forme. La spirale en haut à gauche est NGC 4173 et la galaxie en bas à droite NGC 4175. La plus petite galaxie, la plus a droite, est NGC 4174 et la dernière (une elliptique) est NGC 4169. La galaxie spirale NGC 4173 n'est distante que d'environ 50 millions d'années-lumière alors que les trois autres sont à une distance d'environ 180 millions d'années-lumière, ce qui indique que NGC 4169, 4174 et 4175 sont probablement physiquement liées alors que NGC 4173 est sans aucun doute un objet d'avant-plan. Dans le bas de l'image se trouve un essaim de galaxies lointaines connu sous le nom d'amas de galaxies Abell 1495, situé à environ 1,7 milliard d'années-lumière. Cet amas compte plus de 100 galaxies membres et s'étend sur une zone du ciel de la taille d'une pleine lune
Hickson 61 (Com)- 40x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Superbe duo de galaxie dans la Chevelure de Berenice, NGC 4725 a droite et NGC 4747 à gauche. NGC 4725 est une grande galaxie spirale de 170000 a.l. située à environ 45 millions d'a.l., avec un cœur lumineux et des extensions diaphanes. Cette galaxie présente un aspect très original : une barre centrale clairement marquée et un bras spiral unique qui débute sous la forme d’un anneau pour finalement se disperser petit à petit comme un halo autour de la galaxie. NGC 4747 a une morphologie assez particulière, avec ses queues de marées gravitationnelles qui lui font comme une moustache, fruit d'une interaction passée avec sa grande voisine.
NGC 4725 - 4747 (Com)- 40x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
crop à 100% sur NGC 4725
crop à 100% sur NGC 4747
Constellation de la Chevelure de Berenice, la galaxie de L'Œil noir, M64.
M64 (Com) - L - 40 x 60s gain 80/offset 30 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
M64 (Com) - LRVB - 40/15/15/15 x 60s gain 80/offset 30 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
M100 dans la Chevelure de Berenice, pas facile avec son noyau ultra lumineux! NGC 4312 l'accompagne dans ce champ bien garni. M100 est une vaste galaxie spirale de 170000 a.l située à environ 66 millions d'a.l., son noyau est très lumineux et ses bras nettement définis sont peuplés de jeunes étoiles bleues ainsi que de zones Hll. NGC 4312 est deux fois plus proche, à 35 millions d'a.l., et beaucoup plus petite, 52000 a.l.
M100(Com) - 40x60s - L - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
crop à 100%
M100(Com)- 40/15/15/15x60s - LRVB - gain 80/offset 25 - Mode full resolution - T200/600 - Minicam8M - AZ6 GT - PHD - Siril/PS
Pour finir, voici une planche qui regroupe une partie seulement des galaxies acquises récemment avec ce setup, avec l’échelle respectée:
-
Par apricot
Dans la chevelure de Bérénice, il y a un paquet de pellicules galaxies dont ce rapprochement un peu singulier de quatre NGC 4169 4173 4174 et 4175, encore connu sous le nom catalogue de Hickson 61 ou encore "ze box" avec l'accent ricain.
Crop réduit sur la boite :
La perspective est intéressante, car la galaxie en fuseau bleue est beaucoup plus proche à 50 millions d'années lumière tandis que les trois autres sont à 180 millions d'AL.
Les trois au fond sont probablement en interaction gravitationnelle tandis que la plus proche est juste planplan à l'avant plan.
Pour continuer la perspective, il y a dans l'image un amas de galaxies beaucoup plus distantes. L'amas Abell 1495. Il est à 1.8 milliards d'années lumière.
On voit des objets encore plus lointains dans l'image, des quasars, il y en a une vingtaine dans le catalogue Milliquas annoté dans Aladin :
Le plus distant est à z 2.55, sa lumière a mis 11 milliards d'années à arriver jusqu'au Pic !
Pour la prise de vue, T50 perché sur le Pic du Midi, mission avril 2024. Une soixantaine de poses de 2 minutes avec filtres clear, B et R (V synthétique), sur deux nuits.
Bon ciel de Pâques à tous,
Jean-Philippe
-
Par Discret68
Re-bonjour à tous
Je crois que je suis coincé dans la Grande Ourse car c'est encore une galaxie de cette constellation que je vous présente ici. Il faut dire que la Grande Ourse regorge d'objets intéressants à imager.
C'est sur NGC4051 que j'ai jeté hier soir mon dévolu . Cette séquence n'était pas prévue vu la météo annoncée, mais lorsque j'ai vu le ciel se dégager, j'ai mis en route les équipements pour une séquence dont la durée totale était méconnue à priori. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre !
NGC4051 est une galaxie spirale située à environ 44,7 millions d'années-lumière et qui présente un diamètre plutôt modeste d'environ 78 100 années-lumière.
Coté setup, c'est le newton de 300 en f/d 4, le correcteur TS Wynne 3", l'Integra85 en focuser/rotateur, un filtre Astronomik Luminance L-2 en 50x50 et la caméra ASI2600MC.
L'image finale est composée de 48 brutes de 240s de temps de pose unitaire, ce qui nous fait une durée d'intégration de 3h12'. Les nuages ont quand même fini par arriver ! Je me contente néanmoins de cette durée pour en lancer un empilement/traitement.
L'image du champ complet, à la résolution de 3200 x 2100 pixels :
La version annotée :
Un petit focus sur NGC4051 :
Bonne journée
Jean-Pierre
-
Par b2
Bonjour,
Quelques prises sur la galaxie de l'œil de crocodile (M94) lors d'un aller retour dans la Nièvre.
Située dans la constellation des chiens de chasse à environ 17 millions d'AL (diamètre apparent d'environ 14').
Grosse déception lors de l'empilement, l'image "stackée" était vraiment atroce et je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire de ça!... Une nuit de perdue?!...
Après pas mal d'essais de traitements pas très convaincants, je me suis arrêté sur cette version. Je tenais à ce que le double halo soit visible (peut-être un peu trop).
Coté Setup :
FSQ85 avec extendeur x1,5 sur EM200 Temma 2M, camera Player-One Ares C-Pro, filtre Luminance Anti UV/IR de la même marque, autoguidage ASI220 MM mini.
Acquisition NINA, prétraitement/traitement Siril,Pixinsight, photoshop.
Luminance : 80x180" + 60x60"
J'espère qu'elle vous plaira.
Bon ciel à toutes et tous
-
-
Évènements à venir
-
-
-
-
06 juillet 2025 08:00
Jusqu’au
07 juillet 2025 21:59
-