|
La
belle aurore !
Rapport
sur la tempête géomagnétique du 6 avril 2000 (VI)
Mieux
qu'une explication théorique ou des images muettes, il m'a semblé utile de vous présenter
un rapport sur l'activité aurorale du 6 avril 2000 qui intéressa non
seulement les géophysiciens mais également de nombreux observateurs
occasionnels. Bon nombre d'amateurs ont en effet observé ce jour là
leur première aurore boréale !
Mettant
en corrélation l'activité solaire, géomagnétique et aurorale
durant cette semaine là, vous comprendrez mieux ce qui a provoqué ces
irisations nocturnes et comment lire dorénavant les bulletins
scientifiques en saisissant tout le sens des indices et
autres échelles de mesure.
Au cours du XXe siècle
nous n'avons observé qu'une dizaine de tempêtes géomagnétiques de
l'ampleur de celle du 6 avril 2000 qui nous gratifia de magnifiques
aurores polaires multicolores ainsi qu'en témoignent les clichés
présentés dans les trois dernières pages.
Pour
rappel, voici la liste dressée par la NASA des plus fortes tempêtes du siècle dernier
: 31 oct-1 nov 1903, 25 septembre 1909, 13-16 mai 1921, 16 avril 1938, 11
février 1958, 8 juillet 1958, 4 août 1972, 19 décembre 1980, 13-14
mars 1989, 6 avril 2000.
Pour
bien commencer le troisième millénaire une tempête de même
amplitude se manifesta le 4 avril 2001. Cela n'avait rien d'étonnant
puisque nous étions toujours dans la phase d'activité maximale du 23e
cycle solaire, l'intense activité aurorale chutant à partir de 2002.
Si nous avons une bonne
idée du mécanisme qui produit les aurores, rien n'a encore été dit
sur la source d'un tel phénomène. Quelles sont les signes
avant-coureurs de cet événement ? Bon nombre d'entre nous aimerions
savoir si l'aurore que nous avons observé suivait ou non une activité
anormale sur le Soleil les jours précédents ? Y a-t-il eu une
éjection de matière coronale ? Quelles furent l'intensité des particules
émises ? Quels furent les effets sur la magnétosphère terrestre ?
Voilà autant de questions et bien d'autres auxquelles nous allons répondre
sur base des mesures effectuées par les sondes spatiales GEOS, SOHO et autre
WIND. Mais avant tout je vous propose de consulter les différents indices et échelles
utilisés dans ce domaine pour comprendre le sens des codes utilisés.
L'activité
solaire
L'observation
du Soleil dans le rayonnement X est un bon indicateur de l'éjection
de matière coronale vers la Terre sans pour autant être la cause
directe des aurores. Ces éjections principalement constituées de
plasma sont d'ordinaires accompagnées d'éruptions solaires sous
forme d'éruption chromosphérique ou
de CME.
|
Message reçu par l'auteur:
Date: Thu, 6 Apr 2000 19:01:23 +0000 (GMT)
From: Simon Plunkett
To: <maillist>
Subject: Halo CME on 2000/04/04
LASCO and EIT observed a full halo event on 2000/04/04. This is presumably
the cause of the shock that was observed at ACE today. The CME was first
observed in a C2 frame at 16:32 UT, following a data gap of about ninety
minutes. The leading edge of the CME had already left the C2 field of view
at this time. Measurements in C3 indicate a plane-of-sky speed of 984 km/s
at PA 260 (W limb). The event was brightest and most structured over the
West limb, where a bright core was observed behind the leading edge. The
appearance was more diffuse and fainter in the east.
EIT observed a C9 flare in AR 8933 (N18 W58) at 15:24 UT, that was
probably associated with this flare. A large area of dimming between AR
8933 and AR 8935 (S07 W34) was also observed in EIT around the same time.
Images and movies of this event are available at the LASCO ftp
server :
ftp://ares.nrl.navy.mil/pub/lasco/halo/20000404.
Simon Plunkett.
NASA Goddard Space Flight Center.
-----------
Traduction
succincte : Une CME en halo est apparue le 4 avril 2000 à
16h32 TU, se déplaçant à 984 km/s à partir du limbe ouest
du Soleil. Antérieurement, vers 15h24 TU une éruption de
classe C9 est apparue dans la région active AR8933 et fut
probablement associée à cette éruption.
Ce
type d'alerte et bien d'autres sont disponibles sur le site du
SWPC
de la NOAA soit en direct soit par souscription, sous forme exhaustive ou
abrégée.
|
Les
rayons X traversant l'espace à la vitesse de la lumière (il s'agit
de photons de très haute énergie), ce sont eux qui atteignent les
premiers la Terre mais ils n'ont pas une grande influence sur la
magnétosphère ou l'atmosphère. Après l'arrivée des rayons X, des
particules (relativistes) de très haute énergie (ions et
électrons) arrivent sur Terre, suivis par des particules d'énergie
de plus en plus faible. L'essentiel d'une CME est constitué de plasma
de relativement basse énergie, souvent conduit par une onde de choc.
Ce plasma met 3 à 4 jours pour atteindre la Terre.
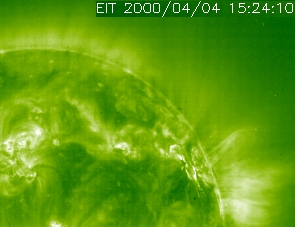 |
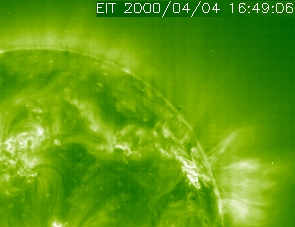 |
|
Le
4 avril 2000 à 15h24 les observatoires LASCO et EIT ont
observé une éruption de classe C9.7 dans la zone
active AR 8933 située sur la partie ouest du
disque solaire (surbrillance du coté droit du disque).
Cette éruption fut probablement associée à la CME qui
apparut une heure plus tard. Document NAVY-LASCO-SOHO |
|
Le
4 avril 2000, la région solaire active AR8948 (15°S,65°E, lat.hélioc.130°)
produisit des éruptions isolées de rayonnements X de classe M dans
la bande XL entre 0.1-0.8 nm. La région solaire active AR8933 (18°N,58°O,
lat.hélioc.267°) produisit à son tour un événement de
classe C9.7 qui fut corrélé avec un phénomène optique 2F à 15h41
TU qui dura 133 minutes. Cet événement fut accompagné de la
disparition d'un filament (DSF) et d'une éjection de matière
coronale (CME), deux phénomènes sources indirectes d'aurores.
C'est cette dernière manifestation qui fut à l'origine de la tempête géomagnétique
du 6 avril au soir.
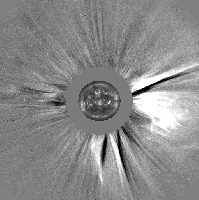 |
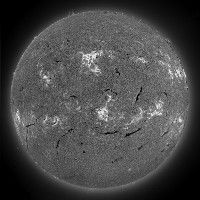 |
|
A
gauche, le 4 avril 2000 à 16h32 TU, les instruments LASCO et EIT
embarqués à bord de SOHO ont enregistré une CME en halo dont la vitesse atteignit 984 km/s
dans le plan du ciel ! Elle fut vraisemblablement à
l'origine du shock observé le 6 avril dans la
magnétosphère terrestre. Au centre le disque du Soleil
photographié au même instant en lumière ultraviolette
par SOHO.
A
droite, le 4 avril 2000 à 17h17 TU le disque solaire présentait en hydrogène-alpha un
nombre impressionnant de filaments (lignes sombres) et de
plages faculaires (zones brillantes), significatifs
d'une activité magnétique très intense et localement
très concentrée. Cliquez
ici pour l'agrandir au format 2032x2032 et
découvrir tous ses détails (376 KB). Documents
NAVY-LASCO-SOHO. |
|
L'activité
solaire fut faible le 5 avril et modérée le 6 avril en raison de
l'activité de la région active AR8948 qui produisit une nouvelle émission
M1/2B à 02h29 TU. Le 7 avril, l'activité retomba et devint à
nouveau modérée les deux jours suivants avec deux émissions de classe M.
|
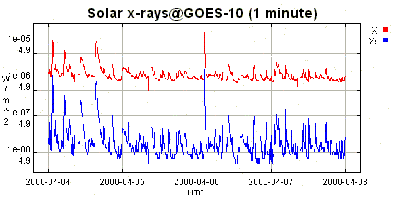
Variation
du flux de rayonnement X du 3-10 avril 2000. En rouge la bande
XL, en bleu la bande XS. Noter les deux éruptions de classe M le 4
avril (> 10-5
Watts/m2).
Document SPIDR-NGCD-NOAA.
|
Comme
nous le verrons un peu plus loin, le 6 avril au soir la magnétosphère
était très compressée suite au passage de l'onde de choc du vent
solaire et les tempêtes géomagnétiques ont entraîné l'apparition
d'aurores très brillantes. Aussi on ne peut pas dire que les rayons X
émis par le Soleil le 4 avril ont directement provoqué les aurores
mais ils indiquaient qu'une CME arrivait sur Terre, laquelle allait
vraisemblablement induire la formation des aurores.
Du
3 au 9 avril 2000, la région active AR8948 fut donc la plus active, tant en
rayonnement X, radio qu'en lumière visible, passant assez rapidement de 4 à 52
taches distinctes pour une extension héliocentrique qui s'étendit
progressivement de 5 à 12°. Le 4 avril, cette région active fut classée comme groupe
Cso dans la classification modifiée de Zurich
et devint un groupe de classe Eai le 8 avril. Le 9 avril, elle présentait une structure
bipolaire "gamma-delta", la plus complexe dans la
classification magnétique.
Prochain chapitre
Les
perturbations radios et le vent solaire
|