Le principe anthropique
L'évolution cosmique (I)
S'il n'est pas de bon ton de
mêler la philosophie à la science, à quelques reprises dans les pages
de ce site nous avons dû faire référence à des principes
irrationnels, et disons-le carrément "métaphysiques"
pour expliquer certains phénomènes, en particulier dans
l'interprétation des résultats d'expériences de
physique quantique, tout en précisant les limites de cette démarche.
Ces rapprochements
sont un mal nécessaire et même si en théorie ils sont évitables (il
suffit de s'en tenir aux théories validées en se disant qu'elles sont
incomplètes et de chercher mieux sans pour autant verser dans les
pseudosciences), jusqu'à un certain point on peut démontrer qu'ils peuvent être
scientifiquement valables (par exemple en tant qu'hypothèse de travail), même si paradoxalement tout scientifique
préfère éviter les sujets métaphysiques lorsqu'il parle de science !
L'idée du "principe
anthropique" compte parmi ces théories "borderline" ou
"cas-limites" qui prétend que les évènements n'arrivent pas de
façon aléatoire. Ainsi, des érudits égyptiens à Newton, ils reflétaient un
certain ordre sous-jacent de nature spirituelle, dans lequel la fatalité
occupait une certaine place.
Le principe
d'un cosmos fini (ayant un début et une fin) ou cyclique est un concept
convergent de nos civilisations, repris en d'autres termes dans plusieurs
religions (ou philosophies de même inspiration) dont la
judéo-chrétienne, l'hindouiste et la taoïste. Dans son expression
moderne, étant donné que la théorie du Big Bang résiste aux assauts
des plus sceptiques, les lois naturelles semblent immuables, distinguant
un état initial à partir duquel l'Univers prit forme pour donner la vie.
Mêlée
de théologie et de philosophie, la science a accepté de définir ce qu'on appelle un
"principe anthropique", qui considère la place morale de
l'Homme dans ce grand ensemble que forme l'Univers. On parle de principe
et non de théorie car à l'inverse d'une théorie fondée
mathématiquement, c'est une proposition, une hypothèse purement
imaginaire qu'on ne peut pas valider ou démontrer par l'observation et
qui ne peut faire l'objet d'aucune prédiction vérifiable. Les
philosophes ainsi que les scientifiques ont essayé depuis longtemps
d'écarter cette inspiration
divine de l'évolution, mais en vain. Certains ne virent qu'un
accident de la nature mais d'autres affirment que ce serait nier notre propre évolution.
Cette conception, énoncée par le
philosophe grec Anaximandre (fl. 610 avant notre ère) se divise en deux courants :
-
Le principe anthropique fort
-
le principe anthropique faible.
Le
principe anthropique faible
invoqué dans cet article est apprécié des philosophes mais laisse tout de même
perplexe les scientifiques; c'est toutefois la seule explication qui
pousse les chercheurs à poursuivre leurs recherches.
|

|
|
Eclipse
totale de Soleil du 26 février 1998 à Curaçao où quand dame
Nature semble synchroniser la mécanique céleste. Document
T.Lombry. |
Dans
leur livre publié en anglais consacré au "Principe
anthropique cosmologique" (1988), John Barrow, Frank Tipler et leurs collègues
considèrent que l'évolution de l'Univers a débuté dans
l'indétermination et le hasard "cumulatif", cherchant une
orientation à travers le temps. Un concours judicieux de circonstances,
une structure atomique prête à subir des changements plus complexes
forma les molécules, les étoiles. Rassemblées en galaxies, elles ont
édifié soleils et planètes pour aboutir à l'apparition de la vie et à
l'émergence d'observateurs. Par hasard, au gré des mouvements orbitaux
et des résonances orbitales, dame Nature nous a offert le plaisir de
contempler les éclipses et les conjonctions planétaires parmi d'autres
phénomènes obéissant à ce qu'on appelle erronément les lois de la
mécanique céleste, comme si dame Nature les orchestrait, sous-entendant
que quelqu'un dirigerait ce concert démesuré des choses qui nous
entourent.
Selon
le principe anthropique faible, les conditions qui préludent à la vie
semblent limitées à notre région de l'Univers, même si l'on admet a priori l'universalité
des lois de la nature : c'est le principe copernicien.
Sur cette évolution il ne peut y avoir de divergences, sauf au sein de
quelques groupes réfractaires, pour ne pas dire de croyants sectaires.
Prétendre le contraire serait la négation
du discours scientifique. Carl Sagan et Hubert Reeves notamment ont très clairement
démontré les différentes étapes de ce processus plus communément
appelé "l'évolution cosmique".
Pour
Heinz Pagels
cependant le principe anthropique n'a rien d'étonnant car il n'a aucune
valeur scientifique. Il considère en effet que nous fondons notre
raisonnement sur un concept anthropique qui n'a aucune valeur aux yeux
d'une civilisation extraterrestre. En fait Pagels interprète le principe
anthropique comme étant à l'effigie de l'humanité. Or dans sa version
faible le principe anthropique ne fait que préciser les conditions
d'émergence d'observateurs.
Malheureusement, ce principe
n'explique pas la raison d'être des constantes fondamentales de la
physique. C'est la raison pour laquelle en 1974 Brandon Carter
invoqua un principe anthropique fort.
Celui-ci suppose qu'il peut exister d'autres Univers, à moins que
certaines régions de notre Univers aient leurs propres lois physiques,
issues d'une époque primordiale où chaque "domaine" de
l'Univers avait le choix de sa configuration. Mais dans tous les cas ces
environnements sont hostiles et n'ont pas ce caractère particulier qui
permit le développement de la vie. Si nous existons et nous posons cette
question, c'est parce que toutes les lois de la physique sont les mêmes
partout, que les conditions physiques ou chimiques qui régissent les lois
n'accordent que peu d'arbitraires. Finalement l'aboutissement de la vie
fut déterminé dans une petite fourchette de variations, rendant les lois
de la nature immuables, ne tolérant pas le hasard pour aboutir à
l'Homme. Ainsi, l'Univers ne permettrait le développement de la vie que
sous l'inspiration d'un Créateur, seul habilité à choisir les lois qui
nous gouvernent. A défaut de pouvoir prouver cette théorie et face au
scepticisme de ses détracteurs, en 1983 Carter nuança cette finallité en
évoquant les "étapes
évolutives difficiles" de l'évolution. Mais nous verrons qu'un nouveau
modèle de l'évolution proposé en 2025 contredit totalement cette
idée.
Voyons
à présent quels sont ces lois qui nous seraient favorables, ces
configurations atomiques particulières qui auraient déterminé
l'émergence de l'Homme. Qu'on n'y croit ou pas, ce sont des faits, des
rapports chiffrés. Tout le problème est de savoir si nous les
interprétons correctement ou s'il s'agit une fois de plus d'une dérive
d'intellectuels ou de personnes trop portées sur l'ésotérisme, ce que
certains appellent plus simplement "de la foutaise". Mais que
les rationnels se rassurent en se rappelant que ce n'est pas une théorie
mais un principe que rien ne vient démontrer.
Les coïncidences des grands
nombres
Aimez-vous
les chiffres ? Sans doute un peu si vous m’avez suivi jusqu’ici. En
1920, Eddington
avait déjà soulevé l'étrange coïncidence des constantes fondamentales
de la physique avec le cycle de la vie. Il mis en évidence un étrange
rapport entre les différentes constantes universelles, dont les
expressions sont reprises dans le tableau ci-dessous.
La troisième expression, appelée le "Nombre de
Eddington" représente le rapport entre la masse de l'Univers actuel
et la masse du proton. Eddington fit remarquer que les deux premières
expressions (1) et (2) étaient approximativement égales entre elles et
que la troisième (3) valait à peu de chose près le carré de
l'expression (1) ou (2). De prime abord ces relations semblent
artificielles, mais il ne s'agit pas simplement de juxtaposer des
constantes fondamentales, ces trois expressions traduisent l'évolution de
l'Univers. La raison pour laquelle ces différentes grandeurs coïncident
mérite bien quelques instants de réflexion.
|
Les
grands nombres en cosmologie |
|
Intensité de l'interaction
gravitationnelle |
|
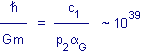
|
(1) |
|
Rapport du diamètre de
l'univers sur le diamètre du proton |
|

|
(2) |
|
Avec
c la vitesse de la lumière, G la constante de la gravitation,  le quantum d'action (la constante de Planck h/2π) et Ho la constante de Hubble
le quantum d'action (la constante de Planck h/2π) et Ho la constante de Hubble |
|
Nombre
de Eddington |
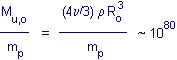
|
(3) |
Avec Mu,o la masse de l'Univers, mp la masse du proton et
ρ la densité de l'Univers, l'indice o faisant référence à
l'époque actuelle. |
|
En 1937, le physicien Paul Dirac
se demandait quel était le rapport entre la force gravitationnelle et la force électrostatique
- dite électrique - ? Nous savons que la force gravitationnelle qui soude tout l'Univers est d'une
intensité de loin inférieur à la force électrique qui maintient les atomes en molécules.
Ce rapport est de l'ordre de 4.17 x 1042
la force électrique est 4 millions de milliards de milliards de milliards
de milliards de fois plus forte que la gravitation !
Au
cours d'une conférence donnée dans les années 1970, Dirac se
demandait comment pouvait-on expliquer un si grand nombre à 40 chiffres... "
Et bien dit-il, vous pouvez essayer de le relier à un autre grand
nombre sans dimension. L'âge de l'univers par exemple". Exprimé
en unités atomiques, on découvre avec surprise que ce nombre vaut 1039.
Dirac
découvrit d'autres coïncidences : le rapport entre la masse de
matière contenue dans l'univers visible et celle du nucléon correspond
au nombre de particules contenue dans l'univers, soit 1078,
le carré de 1039 ! Le rapport entre le
diamètre de l'univers observable et le diamètre du proton, vaut lui
aussi environ 1040 (équation 2),
curieuses
coïncidences ! Les plus sceptiques mettent ces rapports dans le même
panier que le Nombre d'or ou les paramètres caractéristiques des
pyramides.
Pour
Dirac, il ne s'agit pas de coïncidence. Leur intensité respective
semblerait varier, directement ou inversement, en fonction de l'âge de
l'univers. Mais sa théorie soulève une difficulté inattendue. Si la constante
de la gravitation G vaut disons 1 aujourd'hui (soit
6.67x10-11 m3/kg/sec2,
puisque l'Univers n'a pas toujours eu les mêmes dimensions et fut
autrefois aussi petit qu'un proton, le rapport entre nos deux grandeurs a
pu être égal à l'unité dans le passé. Mais cela signifie que la
constante de la gravitation changerait au cours du temps. En clair,
l'attraction entre les corps aurait été différente hier qu'elle ne
l'est aujourd'hui. Pourtant, il semble que depuis l'Antiquité les planètes
ont toujours gravité autour du Soleil comme elles le font aujourd'hui.
Bien sûr, rien ne prouve qu'il en est de même à grande échelle.
Pour être plus précis, il faut mesurer la constante de la
gravitation et cela a pu être fait depuis plus d'un siècle. Toutes les
expériences réalisées avec des pendules de torsion
indiquent que les résultats les plus précis s'excluent mutuellement (6.670, 6.672, 6.674, etc).
De nouvelles mesures effectuées lors des missions spatiales
et sur un pulsar binaire
confirment également que G ne varie pas d'un facteur supérieur à 2x10-12
par an. Les seules variations constatées dépendent, parmi d'autres, de la
température, de l'époque, de la magnétisation, de l'état de
radioactivité et de la charge électrique de la matière soumise au test.
|
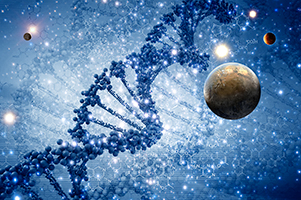
|
|
La
chaîne du vivant. |
Cette conclusion verse de l'eau au moulin des sceptiques mais elle
n'explique pas l'équivalence des deux rapports. Pourquoi 1040,
pourquoi pas un autre nombre ? Il semble de fait que la seule théorie
pouvant expliquer ces grands nombres soit un modèle dans lequel ces
constantes peuvent varier. Cela signifierait qu'elles seraient liées à l'évolution dynamique de
l'univers et seraient donc des constantes fondamentales irréductibles.
Le vrai visage de la nature ne se révèle pas seulement dans les mathématiques.
Peut-être un philosophe pourra-t-il y répondre.
En
attendant sa réponse, Robert Dicke
explique ces coïncidences d'un point de vue anthropique en décomposant
les deux premières relations. L'âge de l'Univers vaut approximativement l'inverse
de la constante de Hubble. Puisque la durée de vie des étoiles doit être compatible avec
l'apparition des molécules organiques, il découle nécessairement une coïncidence
entre les expressions (1) et (2).
Reprenant
l'idée anthropique de Dicke, Brandon Carter
résolu la troisième expression en stipulant que "La présence
d'observateurs dans l'Univers impose des contraintes, non seulement sur l'âge
de l'Univers à partir duquel ces observateurs peuvent apparaître, mais
aussi sur l'ensemble de ses propriétés et des paramètres fondamentaux
de la physique qui le caractérise".
Freeman
Dyson
appuya sa démarche, ayant le sentiment que "tout semble s'être passé
comme si l'Univers devait, en quelque sorte, savoir que nous avions à
apparaître". Néanmoins, ainsi qu'il le précisa au cours d'une interview,
il déteste le substantif "anthropique", trop centré sur notre
petite personne.
Le principe anthropique fort
expliquerait également la non découverte de la désintégration du
proton. S'il est difficile d'observer cet évènement dans la nature,
cela peut provenir du fait que notre
propre existence est liée au phénomène inverse : créer la matière
avec la production de proton à une époque où l'espace contenait un
nombre indistinct de quarks et antiquarks, base de l'édifice baryonique.
Mais qu'est ce qui a conduit l'Univers à privilégier la matière plutôt
que l'antimatière ? Nous avons vu en physique quantique comment Cronin,
Fitch et Sakharov démontrèrent que les interactions fortes violaient la symétrie
C et CP, le méson K° se désintégrant plus facilement en produisant
des positrons devenant quarks qu'en leur antiparticule. Lié au phénomène
d'entropie et à l'impossibilité d'inverser la flèche du temps,
l'Univers semble donc a posteriori avoir privilégié la matière en
fonction d'une finalité, notre présence.
En faisant appel à une notion de
finalité, le principe anthropique conduit aussi à sa perte. Car si les
lois de la physique auraient pu être multiples, même les lois qui
gouvernent l'Univers seraient en désaccord avec la théorie quantique de
l'état singulier du Big Bang et son évolution ultérieure. Il semble
donc que les seules variations possibles aient été celles d'un choix
d'Univers parmi différentes configurations initiales. Cela nous ramène
à sa version faible. Cette démarche tient compte de conditions nécessaires
mais nullement d'une finalité.
Aussi, nous devons récuser le
principe anthropique fort. Si des Univers parallèles existent, ils n'ont
en tout cas aucune influence dans le nôtre et cette idée s'évanouit. Si
l'Univers a été créé en fonction de l'Homme, rien ne lui dictait
d'imposer aux autres galaxies d'être identiques à la nôtre. Tout au
plus les étoiles du bras d'Orion de notre Voie Lactée devraient-elles être
ce qu'elles sont, composées d'éléments enrichis pour donner naissance
au Soleil et à la vie.
Au su des découvertes de la science, on ne peut pas imaginer que l'Univers
fut créé avec l'image de l'Homme en filigrane. Nous en serions flattés, mais
ce serait faire fi de toutes les découvertes accumulées en physique, en astronomie,
en chimie, en biologie et en paléontologie.
Un
trait d'union entre physique et biologie
Même si on ne croit pas au principe
anthropique, il faut bien reconnaître que les coïncidences des grands
nombres n'ont pas d'explications simples. En étudiant les conditions d'émergence
de la vie, on peut en effet démontrer que certains rapports de masse des
particules élémentaires et certains paramètres cosmologiques (dimension
de l'univers, propriétés du cosmos à grande échelle, etc) ne peuvent
varier que dans des limites assez étroites. C'est particulièrement vrai
pour la constante cosmologique qui assure un juste équilibre entre
expansion et contraction de l'univers (voir page suivante). Si cela ne
prouve en rien que la vie devait apparaître dans les conditions actuelles
de l'univers, ces coïncidences forcent malgré tout les physiciens à se
pencher un peu plus vers la biologie.
Ce
que l'on peut dire avec certitude, c'est que nous ne sommes pas
seulement le fruit du hasard. Si c'était le cas, il aurait fallu
attendre bien plus longtemps que la durée de vie de l'Univers pour
que la chaîne de nucléotides élabore par hasard la chaîne d'ADN
et d'ARN qui aboutit au genre humain. Cette probabilité à moins d'une
chance sur 1015
d'apparaître. En outre, il aurait fallu attendre que le hasard
agence les molécules de la vie jusqu'à former un organisme complexe.
A partir de quelques molécules d'ADN et d'ARN, la nature aurait dû
essayer toutes les combinaisons possibles pour voir émerger l'intelligence.
La probabilité est inférieure à 1/1080 !
A choisir entre le hasard et la nécessité de Jacques Monod, aucune des
deux explications n'est satisfaisante. Nous sommes obligés de choisir une
solution intermédiaire, ce que qu'il convient d'appeler le hasard cumulatif,
seul processus capable de créer de nouvelles espèces en quelques dizaines
de milliers d'années par accumulations de mutations.
Une alternative pour expliquer l'apparition relativement rapide de la vie
sur Terre est de considérer la panspermie.
Les scientifiques hésitent en effet à considérer que la vie est apparue localement,
même dans un milieu propice et aussi dense que l'air ou l'eau. Les
bioastronomes ont tendance à favoriser l'hypothèse selon laquelle la
vie est apparue sur Terre suite à une contamination extraterrestre par le
biais d'un impact cométaire par exemple. Si nous découvrons des
exoplanètes ou des comètes abritant la vie, cette théorie sera renforcée. Reste à
prouver que la panspermie est un processus ordinaire de propagation de la
vie dans l'espace. Elle se heurte toutefois au problème du froid, de l'effet
des rayonnements ionisants et des distances à parcourir. Quant aux
extraterrestres, rien de vraiment concret appuye cette hypothèse. Mais à
force de chercher l'origine de la vie, nous trouverons bien un jour la
réponse, qu'elle nous vienne de la science ou d'ailleurs.
Prochain
chapitre
Les
constantes de couplage |