|
La théorie de Gaïa
|
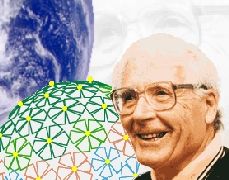
|
|
James Lovelock. |
Concept
scientifique et religion (V)
De
manière assez inattendue la théorie de Gaïa est tout autant un
concept scientifique - dans la mesure où elle serait testable -
qu'une théologie de l'aveu même de James Lovelock
: "Pour moi écrit-t-il, Gaïa est une religion autant
qu'un concept scientifique, et dans les deux sphères, elle est
gérable... Dieu et Gaïa, la théologie et la science, tout comme la
physique et la biologie ne sont pas séparées mais forment une
unité de pensée".
D'un
point de vue philosophique, l'humanité dit Lovelock, se trouve à la
périphérie des systèmes vivants sur la Terre. Notre vision
anthropocentrique implique que nous préservions la Terre comme nous
l'entendons.
Mais
cette idée de pouvoir régir la planète est une idée absurde et
dangereuse car nous ignorons toutes les interactions qui se
manifestent dans la biocénose : "On n'en sait jamais trop...
La réponse est 'mains en l'air'".
La macrofaune est l'iceberg sur le
gâteau; la base de la vie est la microbiologie. Ces
micro-organismes dirigent le système et nous ne pouvons pas les
influencer et dans cette mesure nous sommes probablement incapables
de détruire la vie sur Terre. Nous pouvons réfreiner certaines de
nos attitudes destructrices mais cela soulève de profondes
questions concernant la responsabilité des individus et des groupes
sociaux. Est-ce que nous devons donner une valeur à la continuité
de la vie en général, à l'expérience humaine ou aux sentiments
des animaux ? Pourquoi s'en préoccuper si nous détruisons les
espèces ?
Aussi,
d'un point de vue philosophique, les idées Gaïennnes proposent une
alternative à la vision mécaniste du monde, une meilleure
compréhension que le réductionnisme qui vise à tout réduire en
ses parties. Cette nouvelle vision montre que le monde vivant est
interconnecté, et dans une certaine mesure, vide de sens. Dès lors
pourquoi ne pas instaurer une nouvelle métaphore du vieille adage
"le monde comme machine".
Dans son article "Gaïa in
Action", David Abraham suggéra que ce changement de sens
supprimerait l'idée du "concepteur" extérieur qui d'une
certaine manière ressemblait à un être humain fabriquant des
machines. Cela évite de tomber dans le piège considérant que
nous pouvons traiter la nature comme une machine et cela nous permet
de retrouver l'idée que nous sommes immergés dans le monde comme
participants. Le monde Gaïen aurait plus à gagner de la
coopération que de la compétition, en intégrant les organismes et
leur environnement plutôt qu'à lutter et défier la nature - entre
nous cette vision holistique fait partie des arguments écologiques
européens depuis les années 1980.
D'un
point de vue éthique, certains auteurs telle Kate Rawles se
demandent si cette conception s'étend au-delà des êtres humains,
à tous les êtres sensibles ? Aux écosystèmes ? A la planète ?
Quels genres d'obligations et de responsabilités cela implique-t-il
? Est-ce que la théorie de Gaïa sugggère l'existence d'objectifs
et de valeurs spécifiques à l'environnement ? Peut-elle nous dire
comme nous devons agir ? Retire-t-elle aux êres humains la position
suprême qu'ils assument au sommet de l'évolution, et dans ce cas
qu'y a-t-il au-delà ? Si aujourd'hui la plupart de ces questions
sont encore du ressort de la philosophie, un jour ou l'autre les
scientifiques devront y répondre ainsi que les politiciens.
Il
y a enfin d'autres implications. L'image Gaïenne permet aux êtres
humains de se donner une signification (en raison de leur conscience
et auto-réflexion) et de se considérer comme une partie
significative d'une interaction à l'échelle globale. Si la Terre
doit être considérée comme un organisme vivant capable de se
préserver, devons-nous la respecter voire même la vénérer ? Une
compréhension de Gaïa peut-elle aboutir à des attitudes que nous
appelerions "religieuses", capables d'influencer l'impact
humain sur les processus planétaires ? Lovelock en tous cas le
crois.
En
guise de conclusion
Objectivement,
on ne peut nier toutes les questions philosophiques qui surgissent
dès que l'on creuse un peu le concept de Gaïa. S'il est évident
que cette théorie présente des faiblesses et peut subir plusieurs
niveaux de lecture, il est aussi évident à travers le cadre
de recherche qu'elle procure que Gaïa permet d'illustrer de quelles
manières la Terre répond à un stress.
Jusqu'il y a peu on pensait
que la Terre s'adaptait uniquement face aux changements naturels. Grâce
à Gaïa, les scientifiques ont découvert qu'elle devait aussi répondre
à l'impact des hommes, à travers les effets de la pollution de
l'air et les interférences artificielles que cela entraîne sur le
climat global.
Aujourd'hui
la théorie de Gaïa est plus instructive que jamais. Comme les créatures
vivantes, la Terre est un système ouvert mais un système fini, limité.
D'un côté, il est limité par l'espace et c'est à travers l'atmosphère
que nous échangeons du rayonnement avec l'univers. De l'autre côté,
notre planète est limitée par son écorce solide dont les soubassements
océaniques et continentaux échangent de la matière avec le manteau en
fusion. La Terre perd peu d'énergie : une partie infrarouge rayonne et s'échappe
dans l'espace, tandis que dans les zones de subduction les roches
fusionnent avec le manteau. C'est donc le déséquilibre de l'atmosphère
qui demeure la principale variable nous permettant de mesurer la réduction
de l'entropie, du désordre de ce système.
Grâce
aux superordinateurs, les théoriciens sont capables de simuler l'évolution
des modèles
climatiques sur une très longue période, avec un temps de réponse
très raisonnable si on se limite à quelques variables. Nous avons vu précédemment
que Vénus et Mars ne semblent pas abriter de formes de vie. En tous cas celles-ci ont
probablement disparu. Les systèmes régulateurs que nous connaissons sur Terre,
les océans et la couche d'air stratosphérique ont disparu depuis
longtemps de ces deux planètes. Dans ces conditions, irréversiblement,
en quelques millions d'années les modèles théoriques imposent
l'extinction de la vie.
Mais
la composante biologique n'a pas été introduite dans ces modèles.
Devant cette exclusion arbitraire de la vie et par référence à
celle qui survit sur notre planète, on peut faire l'hypothèse
que de nombreux paramètres restent inconnus. Sur Terre, la dérive
des continents et les courants océaniques ont profondément
modifiés les données climatiques. La surface des continents a
aussi considérablement augmenté depuis 200 millions d'années,
modifiant l'influence de l'atmosphère et les propriétés des
masses d'air. Les interactions de ces systèmes et le rôle régulateur
joué par certaines composantes (forêts, gaz carbonique) sur le
climat semblent indissociables de l'évolution des espèces
.
Selon
la théorie de Gaïa, la vie est étroitement liée à l'évolution de
l'atmosphère et de la croûte terrestre. Bien sûr, il n'est pas aisé de
déterminer l'influence de notre souffle sur l'atmosphère ou de nos déchets
sur l'écosystème. Mais certains n'hésitent pas à postuler, feu Carl
Sagan
en premier, qu'un hiver nucléaire détruirait totalement la vie sur
Terre. Le climat en serait si bouleversé pendant si longtemps, que dans
cette éventualité l'extinction des êtres vivants serait inévitable.
Rien
que l'explosion volcanique du Pinatubo en 1991 refroidit l'atmosphère de
0.5°C. Mais nous savons à quel point l'évolution de la vie est le résultat
d'un long apprentissage et d'une constante adaptation au milieu. Depuis
plusieurs milliards d'années notre écosystème est toujours en équilibre en raison
des mutations et des boucles de rétroactions. La vie s'est développée
en symbiose avec l'environnement. Voici donc une preuve de l'interaction
entre la vie et son biotope.
Mais
le facteur régulateur de température n'obéit plus à notre loi. Malgré
l'équilibre général de la Terre, nous avons connu des périodes glacières.
Pendant les glaciations successives, les êtres vivants inadaptés ont
succombé au froid quoiqu'en dise Lovelock.
Si
la théorie de Gaïa explique l'activité générale de la Terre, l'évolution
des organismes vivants doit être analysée d'un point de vue global, en
fonction de l'activité physico-chimique de la planète hôte.
Dans
ce cadre, Caldeira et Kasting ont développé un modèle de ce type en 1992
afin d'estimer la distribution des organismes dans la biosphère en tenant
compte des phénomènes de rétroactions comme l'altération des roches
par l'activité biologique. Franck et son équipe étendirent ce modèle
en 2000 en ajoutant une description géodynamique des processus géosphériques.
Dans de telles conditions, ils s'avèrent que de nombreuses planètes
pourraient abriter une forme de vie toute différente de celle que nous
avons l'habitude de rencontrer ici bas.
|
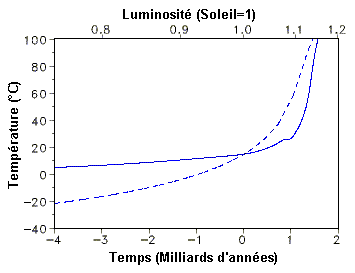
|
|
Evolution
de la température globale de surface dans le modèle de Caldeira/Kasting
(trait plein) et dans un modèle contenant du gaz carbonique atmosphérique
(pointillé). |
|
Mais
ainsi que l'ont rappelé F.Doolittle, R.Dawkins et J.Kirchner, la théorie de
Gaïa n'est pas testable, et il ne s'agit pas non plus d'une hypothèse scientifique dans
le sens de Popper car elle ne peut pas être falsifiée... Si la
définition d'une théorie selon Popper est basée sur le réductionnisme,
il s'agit aussi d'un mécanisme de défense qu'utilise les scientifiques
lorsqu'ils étudient des systèmes trop complexes pour être
compris dans leur globalité. Trop souvent cependant, la science
réductionniste conduit à des non-dits parmi la communauté scientifique
qui conduisent à ignorer les aspects les plus intéressants des
phénomènes qu'ils étudient. Les outils informatiques ont permis de
morceller ces systèmes qui étaient auparavant trop vastes. Espérons que
l'approche de Lovelock ne soit pas rejeté en raison d'une définition à
ses yeux démodée du fonctionnement de la
Science...
Pour
plus d'informations
Site
web de James Lovelock
Lovelock
La Terre est un être vivant,
J.Lovelock, Ed.du Rocher, 1986
Les
Âges de Gaïa, J.Lovelock, Robert Laffont, 1990
L'hiver nucléaire,
C.Sagan et R.Turco, Seuil, 1991
L'origine
de la vie sur terre, A.Oparine, Masson, 1965
Gaïa in Action: Science of the Living Earth,
Peter Bunyard (ed), Floris Books, Edinburgh, 1996
What is Life,
L.Margulis/D.Sagan, Simon & Schuster, 1995
The Practical Science of Planetary Medicine,
J.Lovelock, Gaïa Books Ltd, London, 1991
Hands up for the Gaïa hypothesis,
J.Lovelock, 1990
Science of Gaïa,
J.Kirchner, 1988
Biodiversity,
E.Wilson/E.Wilson eds., National Academy Press, Washington DC., 1988
Limits of life,
C.Ponnamperuma/L.Margulis, D.Reidel, 1980
Gaïa: a new Look at Life on Earth,
J.Lovelock, OUP, Oxford, 1979/1987.
Retour
à la Bioastronomie
|