|
Les éclipses lunaires
Dans
l'ombre de la Terre
Eclairée
par le Soleil, la Terre projette derrière elle un cône d’ombre qui
s’étend dans l’espace sur une longueur d’environ
250000 km ou 39 rayons terrestres. Ainsi que Kepler le suggéra, en
réalité si la lumière solaire n'était pas réfractée dans
l'atmosphère terrestre, le cône d'ombre d'étendrait 5.5 fois plus
loin, sur 1.4 million de km ou environ 216 rayons terrestres.
Le
cycle de Saros définit 84 éclipses lunaires et solaires en moyenne.
Etant donné que les éclipses de Lune peuvent s’observer sur toute
l’hémisphère de la Terre plongée dans l’obscurité, il y a en
fait plus de chances d’assister à une éclipse de Lune qu’à une éclipse
de Soleil. Mais les conditions d’occultation sont plus rigoureuses que
celles qui régissent les éclipses solaires.
Le
plan de la Lune doit former un angle inférieur à 41’10” avec le plan de la Terre
et celui du Soleil (l'axe Terre-Soleil) pour que nous puissions assister à une éclipse ne fut-ce que
partielle. Aussi, le plus souvent la Lune passe à côté de l’ombre
de la Terre. Il y a donc moins d’éclipses lunaires que d’éclipses
solaires avec un maximum de 3 éclipses lunaires par an.
Au
cours du XXIe
siècle, nous aurons l'occasion d'assister à 85 éclipses de Lune dont 40
à 45 éclipses totales depuis un point géographique précis, ce qui
représente environ 1 éclipse tous les 2.3 ans (par comparaison, en un
même lieu, une éclipse totale de Soleil se reproduit en moyenne tous
les 375 ans).
Lorsque
la Lune est correctement placée dans l’axe Terre-Soleil, nous pouvons
assister à 3 types d’éclipses lunaires :
-
L’éclipse par la pénombre, lorsque la Lune ne traverse pas l’ombre
de la Terre
-
L’éclipse partielle, lorsque la Lune traverse une partie
seulement de l’ombre de la Terre
-
L’éclipse totale, lorsque la Lune pénètre totalement dans l’ombre
de la Terre.
La
grandeur d’une éclipse lunaire se définit comme la fraction
de la Lune éclipsée. L’éclipse sera totale lorsque sa grandeur sera
égale ou supérieure à l’unité.Les planètes géantes
Une
éclipse de Lune est caractérisée par 6 moments clés (au maximum) :
- 1er
contact, la Lune entre dans la pénombre de la Terre, l'éclipse partielle commence
- 2e
contact, la Lune entre dans l’ombre de la Terre. Cette phase peut durer
2h30
- L'éclipse totale. Cette phase peut durer 1h46m
- 3e contact, la Lune sort de l'ombre et reprend contact avec la pénombre de la Terre, fin de
l'éclipse totale
- 4e contact, la Lune sort de la pénombre de la Terre
- Dernier contact, fin de l'éclipse partielle.
A
consulter : Shadow
and Substance, Larry Koehn
Simulations des éclipses et
des conjonctions planétaires
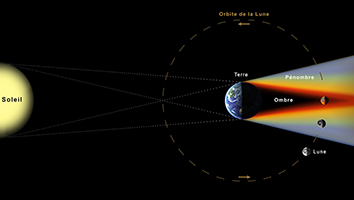 |
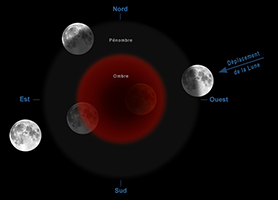 |
|
Ci-dessus,
schémas d'une éclipse de Lune. C'est l'effet de la réfraction
atmosphérique de la lumière du Soleil et la densité des
poussières en suspension dans la haute atmosphère de la
Terre qui déterminent la coloration et la brillance de l'éclipse.
Documents T.Lombry.
Ci-dessous à gauche, photo composite de 3 images, prises
par Colin
Legg
le 31 janvier 2018. Chaque image comprenant 5 photos HDR (5
stops de différence par image) prises avec 2 APN placés en
tandem équipés d'un téléobjectif de 400 mm + téléconvertisseur
2x. On distingue clairement la limite de l'ombre de la Terre
ainsi que les étoiles. La Lune se déplace de gauche à droite
et vers le bas. Voir également la vidéo sur Wimeo.
A droite, l'éclipse du 28 août 2007 photographiée par Sean
Bagshaw
depuis le mont Acacia situé dans les montagnes de Siskiyou
en Orégon. Photo composite prise avec un APN Canon EOS 5D
équipé d'un objectif zoom de 28-135 mm et d'un
téléobjectif de 400 mm. |
|
L’éclipse
durera plus longtemps lorsque la Lune est à l’apogée (au plus loin
de la Terre) et durant l'été dans l'hémisphère nord. Le diamètre du
cône d’ombre projeté par la Terre sur la Lune sera plus petit
mais les lois de Kepler - la loi des aires - prévalent malgré tout :
plus éloignée de la Terre, la Lune se déplace plus lentement sur son
orbite. Ce phénomène est décisif.
La vitesse
de la Lune est d’environ 1 km/s (15'/minute) et la phase totale peut
durer au maximum 1h46m. Une telle durée est très rare. Selon les calculs
de Jean
Meeus, l'éclipse totale de Lune du 16 juillet 2000 qui fut
observée dans l'Océan Pacifique, le sud de l'Asie et en Australie dura 106 minutes 45
secondes, et 3 secondes de plus le 13 août 1859. Ce ne sera pas avant
le 19 août 4753 qu'on pourra assister à une éclipse totale d'une durée
de 106 minutes 35 secondes.
Dans son entièreté et lorsque les
configurations planétaires sont optimales, le phénomène peut durer plus de 6 heures.
Aristarque
et la mécanique céleste
C’est
en observant la forme que prenait l’ombre de la Terre sur la surface
de la Lune, qu’il y a plus de 2200 ans Aristarque parvint à déterminer la
distance Terre-Lune. A condition de connaître le diamètre de la Terre,
il se demanda combien de Lune pouvait-on placer dans l’ombre de la
Terre ? Un problème classique des stages d’astronomie...
|
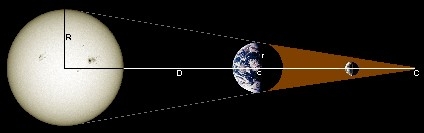
|
|
Quelle
est la longueur du cône d'ombre de la Terre lors d'une
éclipse de Lune ? Si D est la distance Terre-Soleil,
R le rayon du Soleil, r celui de la Terre, la longueur
de l'ombre portée par la Terre sur la Lune cC vaut en
théorie :
Sachant
que la distance Terre-Soleil D ~ 148.5 millions de km, l'ombre
de la Terre mesure 1368664 km de longueur s'il n'y avait
pas de réfraction atmosphérique. En pratique, l'ombre
est 5.5 fois plus courte.
Inversement,
à partir de la taille relative de l'ombre de la Lune,
Aristarque a pu donner une première approximation de la
distance qui nous sépare du Soleil. |
|
Malgré
l’imprécision de ses instruments, Aristarque parvint également à
estimer la distance Terre-Soleil. Bien que son erreur atteignit un
facteur proche de 20, il considérait que le Soleil était 20 fois plus éloigné
que la Lune. Depuis cette époque, mathématiciens et astronomes n’ont
cessé d’arpenter le ciel, cherchant inlassablement notre place dans
l’univers.
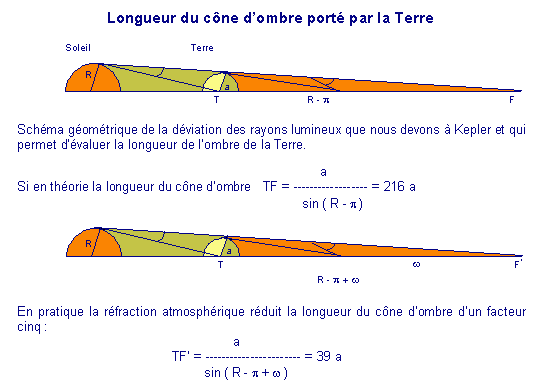
La
couleur des éclipses
La
couleur de la Lune durant une éclipse varie selon les conditions. A
l’instant du 1er
contact, la Lune garde une teinte grisâtre et le phénomène est
pratiquement inobservable pour un néophyte.
Au bout d’une heure,
lorsque la Lune pénètre dans l’ombre de la Terre (2e contact),
le bord est du limbe commence à disparaître. L’ombre
bleue-nuit, quasi noire, envahit sa surface illuminée en formant une
grande échancrure, signe de la rotondité de la Terre. La partie de la
Lune plongée dans l’ombre prendra une teinte orange, phénomène
provoqué par la réfraction de la lumière solaire dans l’atmosphère
terrestre (c'est le même phénomène qui se produit au coucher du
Soleil lorsque ce dernier prend une couleur rouge).
Lorsqu’une heure plus tard la Lune est complètement plongée
dans l’ombre, sa surface prend une teinte cuivrée, d’un rouge plus
ou moins sombre selon la quantité d'aérosols (eau et poussières)
présents dans l'atmosphère terrestre.
La
couleur des éclipses lunaires a été codifiée :
-
Eclipse de type 0 : La partie de la Lune plongée dans l'ombre est
pratiquement invisible et sans couleur
-
Eclipse de type 2 : Pendant l'éclipse totale, la Lune est rouge foncée
avec des contours plus ou moins clairs
-
Eclipse de type 4 : Pendant l'éclipse totale, la Lune est orange avec des
contours parfois bleutés ou verdâtres. La Lune demeure visible dans
l'ombre dans le Terre.

|
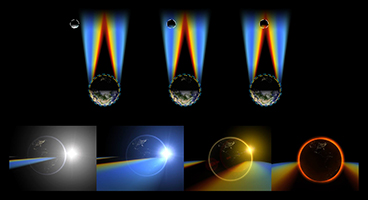
|
|
A
gauche, l'éclipse de Lune du 15 mai 2003 photographiée par Steve
Ruppa au Wisconsin, USA, au foyer d'une lunette Stellarvue
AT-1010 de 80 mm f/5 équipée d'un APN Nikon Coolpix 4500. L'image
originale de la Lune mesure 0.73 mm sur le capteur CCD. Les prises de vues
ont été enregistrées toutes les 7 minutes environ puis compositées. A
droite, changement de couleurs d'une éclipse de Lune en fonction de l'alignement
des astres. Document Solar
astronomy. |
|
Faits
scientifiques et anecdotes
Le
choc thermique
Que
se passe-t-il sur la Lune pendant une éclipse lunaire ? Car il se produit
effectivement un phénomène que les équipages d'Apollo XII (Oceanus
Procellarum) et d'Apollo XIV (Fra Mauro) ont mesuré lors de leur séjour
sur la Lune en 1971.
Pendant
une éclipse totale de Lune, la température à la surface du sol de la
Lune est passée respectivement de +75.7°C à -102.7°C et de +67.8°C à
-102.8°C, une différence supérieure à 170° C.
Les
points chauds
Les
images de la Lune prise en infrarouge durant une éclipse totale de Lune
montrent que sa surface est littéralement criblée de "points
chauds" et de vastes régions plus chaudes que la température
moyenne de surface.
Le
cratère Tycho notamment connu pour son fameux système de rayons à la
pleine Lune est particulièrement brillant en infrarouge. Son rayonnement
provient du régolite du sol qui absorbe plus facilement la chaleur du
Soleil que celle dégagée par l'intérieur de la Lune. Inversement,
Gassendi brille en infrarouge en suivant un profil rappelant la chaleur
dégagée par une source interne.
Bien
que ce phénomène ait été étudié dans le cadre des LTP
depuis plus de 50 ans, aucune théorie définitive explique pourquoi ces
"hot spots" apparaissent lorsque la Lune est plongée dans
l'ombre de la Terre.
A
voir : Hotspots
durant l'éclipse du 28 septembre 2015

Eclipse
de Lune du 3 mars 2007 photographiée par Josh
Valcarcel/US.Navy depuis le vaisseau porte-hélicoptère USS Boxer
(LHD 4).
Cliquez
sur l'image pour charger une version de 3000x260 pixels (252 KB) ou
cette version
HD de 14000x1200 pixels (2.8 MB).
L'éclipse
qui sauva Christophe Colomb
Enfin,
rappelons que c'est une éclipse de Lune qui sauva la vie de Christophe
Colomb et de son équipage. Pendant son voyage vers le Nouveau monde, le
célèbre navigateur aurait emporté avec lui un almanach qu'on suppose
être (car Colomb n'a pas cité ses sources) le Calendarium écrit par
l'astronome allemand Johannes Müller von Königsberg, mieux connu sous
son pseudonyme latin Regiomontanus. Son almanach couvrait la période
1475-1506 et permettait de calculer les prochaines éclipses de Lune.
Au
cours de son quatrième voyage en mai 1502, Christophe Colomb s'échoua
sur la côte nord de la Jamaïque en juin 1503, son navire étant en trop
mauvais état pour rependre la mer. Suite à une mutinerie, certains
membres de son équipage dérobèrent les vivres, obligeant Colomb à
demander de la nourriture et de l'eau aux indigènes. Mais n'ayant pas
peur de Colomb et se rappelant quelques menus pillages survenus au cours
des expéditions précédentes, les Indiens étaient devenus hostiles et
refusèrent de l'aider.
|
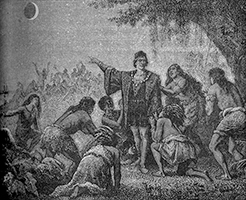
|
|
Christophe
Colomb menaçant les Indiens de Jamaïque en invoquant l'éclipse
totale de Lune le 29 février 1504. |
Fatigué
et malade, Colomb retourna à bord de son navire où il prit le temps de
consulter le Calendarium de Regiomontanus et apprit qu'une éclipse totale
de Lune était prévue le 29 février 1504, soit trois jours plus tard.
Mais les éphémérides étaient calculées pour Nuremberg en Allemagne et
Colomb ignorait à quelle heure locale cela correspondait en Jamaïque.
Désespéré
et à court de vivres, il essaya malgré tout de tenter sa chance pour
impressionner les Indiens. Colomb calcula que la Lune serait éclipsée dès
son apparition sur l'horizon et évalua sa durée à "cinq
sabliers" depuis le coucher du Soleil d'où il déduisit la longitude
de l'évènement (on découvrit plus tard qu'il commit une erreur de 37°
en longitude, ce qui correspond à environ 2h30 d'écart).
La
veille de l'éclipse totale de Lune, Colomb menaça les Indiens en leur
disant que s'ils ne coopéraient pas, la Lune disparaîtrait du ciel la
nuit prochaine en signe de mécontentement du Dieu des Chrétiens. Les
Indiens s'en moquèrent et Colomb attendit patiemment.
Comme
prévu, l'éclipse d'un rouge sombre se produisit effectivement le jour
dit et on peut imaginer quel effroi cet évènement provoqua chez les Indiens.
Forts impressionnés par le pouvoir de Colomb, les Indiens
demandèrent son pardon et de replacer la Lune dans le ciel. Ayant déjà
assisté à une éclipse, Colomb savait qu'elle durerait encore quelque
temps et leur répondit qu'il devait consulter son Dieu. Il se retira dans
ses quartiers pendant une demi-heure, le temps que l'éclipse se termine.
Puis il retourna voir les Indiens, leur annonçant que leurs prières
avaient été exhaussées.
Le
lendemain les Indiens ravitaillèrent le navire de Colomb et l'ont nourri
ainsi que son équipage pendant 4 mois, jusqu'à ce que les secours
arrivent le 29 juin 1504.
Ce
récit historique a inspiré plusieurs auteurs dont Henry Rider Haggard
qui évoqua un phénomène semblable dans son roman "Les Mines du roi
Salomon" (1885, adapté au cinéma en 1936 et en 1950) ou Hergé qui
évoque cette fois une éclipse totale de Soleil dans "Tintin et le
Temple du Soleil" (1948).
Comment
photographier une éclipse de Lune ?
Vous
avez deux possibilités : soit montrer l'évolution de l'éclipse en
cours des 5-6 heures que dure le phénomène en prenant des poses
successives séparées de quelques minutes, ou réaliser des
gros-plans lors des 2e et
3e contacts ainsi qu'au milieu de la phase
totale. Si vous utilisez un appareil photo de 35 mm "full
frame" (FX), il faut savoir qu’une image mesure 24 x 36 mm
de côté. Si vous utilisez un objectif grand-angulaire de 24 mm f/2.8,
il couvrira un champ réel de 53° x 74° en mode paysage, un peu moins avec un 35
mm.
Si
vous disposez d'un logiciel de simulation du
ciel (par exemple Stellarium
qui est gratuit), essayez de simuler le champ de votre appareil photo ainsi
que le déplacement de la Lune au cours de l'éclipse. Cela vous
aidera à déterminer l'orientation de votre appareil photo par
rapport à la trajectoire de l'éclipse ainsi que le meilleur
écart entre chaque cliché en fonction de la focale que vous
utiliserez.
Malgré
le fait que les déplacements de la Lune (comme du Soleil) ne soient pas constants en
azimut et en élévation, nous pouvons oublier ce phénomène car il
s'agit d'une seule surimpression qui n'aura pas besoin d'être
comparée avec d'autres images similaires où la symétrie est
recherchée.
|

|
 |

|
|
A
gauche, l'éclipse de Lune du 20 janvier 2000 photomontage de Kazuyuki
Tanaka, USA. Au centre, animation de l'éclipse
du 21 janvier 2000. Séquence réalisée par
Pedro Ré.
A droite, l'éclipse totale de Lune du 24 mars 1978
photographiée par Akira
Fujii.
Il utilisa un boîtier moyen format Mamiya Press équipé
d'un objectif de 100 mm f/2.8 installé
en parallèle sur son télescope. L'image originale de
la Lune mesure 0.91 mm sur le film. Les prises de vues
en surimpression ont été réalisées toutes les 2
puis ~7 minutes sur film Ektachrome 64, 1/125 de
seconde à f/8 durant la phase partielle et 5 minutes à f/4 durant
la totalité en poursuite lunaire. |
|
Réalisez des prises de
vues espacées d'au moins 1°, soit 2 fois le diamètre de la Lune.
Sachant que la Lune se déplace de 15' par minute, un décalage de 1° entre
les prises de vues correspond donc à prendre une image toute les 4 minutes
(prenons 5 minutes par facilité). A vous de déterminer l'écart optimal qui donnera
le plus d'esthétique à la surimpression.
Seule
difficulté, lorsque la Lune entrera dans l'ombre
de la Terre, l'image sera très sombre et vous devrez facilement
multiplier le temps d'exposition par 5 ou 10. Tenez en compte
tout en évitant le filé qui détruirait la qualité de votre document.
Beaucoup
d'amateurs optent pour la facilité et si l'image du phénomène est
isolée de son avant-plan, ils prennent des photographies
individuelles avec un téléobjectif ou une petite lunette puis
réalisent un compositage par la suite, comme cela a été fait pour
la séquence du 15 mai 2003 présentée un peu plus haut.
Rappelons que le temps d'exposition maximum que vous pouvez utiliser pour que les
traînées des astres n'apparaissent pas sur le photocapteur est de :
T
: Temps d'exposition (secondes)
F
: Longueur focale de votre optique (mm)
D
: Déclinaison du sujet (degrés)
T
= 1000 / (F cos D)
Pour
des prises de vues générales et d'ambiance d'une éclipse ayant lieu à 40° de déclinaison et une optique de 24
ou 35 mm de focale, le temps d'exposition maximal sera respectivement
de 54 et 37 secondes. En réalisant des prises de vues exposées 5 à 10 secondes
durant la totalité vous avez largement le temps de réaliser des
expositions prolongées sans craindre le filé.
 |

|
 |
L'éclipse
de Lune du 27 juillet 2018. Se déroulant à l'apogée, c'était la plus longue éclipse
totale de Lune du XXIe siècle, avec une totalité qui dura près de 103 minutes.
A gauche, une photo prise par Sebastian
Voltmer
depuis la Namibie avec un Celestron NexStar 4SE équipé d'un
APN Sony A7S. Les deux petites étoiles sont Omicron capricorni.
Au centre, une photo prise par Pete
Lawrence depuis
l'Angleterre. A droite, une photo prise par Eric
Recurt
depuis Ténérife. |
Certains
APN compacts bas de gamme sont inutilisables pour
réaliser ce genre de surimpression car ils ne disposent en général
que d'une pose B limitée à 15 ou 30 secondes et certains ne sont même
pas équipés de téléobjectif. La meilleure solution consiste à
acheter un APN réflex ou hybride équipé d'un téléobjectif (zoom ou focale
fixe).
Avant
de vous attaquer à une éclipse de Lune, faites plusieurs essais au
cours d'une lunaison normale pour déterminer le temps d'exposition
sans surexposer l'image (c'est souvent le cas avec les APN compacts)
et obtenir des images régulièrement espacées de la Lune.
Dans la majorité des cas, l'avant-plan sera
surexposé du fait de l'accumulation des prises de vues individuelles
sur la même image. Pensez donc à compositer l'image de l'éclipse
avec une image de l'avant-plan prise juste avant ou après l'éclipse.
Cela demande donc que vous ayez un ordinateur à votre disposition
équipé de quelques logiciels de traitement d'image (par ex. Adobe Photoshop,
Iris, etc, cf. cette liste en anglais).
 |

|
Eclipse
de Lune du 9 janvier 2001 photographiée par Giacomo Venturin,
Italie. |
Eclipse
de Lune du 20 janvier 2000 photographiée
par
Pedro Ré, Espagne.
|
L'autre
solution consiste à utiliser un téléobjectif ou un télescope pour
réaliser des gros-plans en couleurs de l'éclipse. L'image de la Lune
étant 109 fois plus petite que la longueur focale de votre optique,
photographiée avec un APN équipé d'un téléobjectif de 210 mm, comme
sur le document présenté ci-dessus, l'image de la Lune mesure moins de 2 mm !
Le sujet étant de très faible
luminosité, pour obtenir une image détaillée lorsque la Lune
prendra une couleur rouge cuivrée, qu'on travaille avec APN, une
caméra CCD ou avec un boîtier argentique, il est conseillé d'utiliser
des sensibilités de 200 ou 400 ISO. Progrès oblige, les
photocapteurs de nouvelle génération permettent d'utiliser des
sensibilités élevées tout en gardant un niveau de bruit très faible.
Vous
pouvez réaliser une seule photographie à chaque contact et au milieu de
la phase mais vous pouvez également augmenter le rapport signal/bruit et
donc la résolution de l'image en empilant une dizaine d'images prises au
même instant et en traitant ensuite les images individuelles sur
ordinateur.
Si
vous utilisez une webcam ou un APN compact, vous pouvez soit l'utiliser en mode
afocal (en retirant l'optique de la webcam), soit conserver son objectif. Dans tous les
cas utilisez un oculaire de grande focale (un 25 ou un 40 mm selon la
focale de votre instrument) pour contenir toute la Lune.
Si vous
travaillez avec un télescope catadioptrique, vous avez avantage à
ouvrir le champ pour réduire le temps d'exposition en utilisant un
télécompresseur de 0.63x. En passant de f/10 à f/6.3 par exemple, vous
divisez le temps d'exposition par 2.5 (temps d'exposition de 0.4 s au lieu de 1 s).
Toutefois
la tolérance de
mise au point est proportionnelle au carré du rapport focal f/D et
elle sera donc plus étendue si vous utilisez un rapport focal plus
élevé. Il faut donc trouver un justement compromis entre rapport focal
et précision de la mise au point. Ce phénomène intervient
surtout avec une caméra CCD et d'autant plus que la Lune prendra une
couleur rouge sombre, souvent difficile à focaliser, et plus encore
si vous utilisez une lunette achromatique... Bref, il y a beaucoup
d'éléments à concilier pour obtenir une bonne image en haute
résolution d'une éclipse de Lune.
A
voir : The Moon During a Total Lunar Eclipse
Time-lapse
réalisé par Wang
Letian
et traitement par Zhuang Jiajie
|

|

|
|
Eclipse
de Lune du 20 janvier 1999 photographiée par Barnes,
USA. |
Eclipse
de Lune du 24 octobre 2004. Photomontage de Fred Espenak, USA. |
Pour
les prises de vues en haute résolution, abandonnez l'idée d'exposer
correctement la région plongée dans l'ombre et simultanément la partie brillante
non éclipsée. La différence de contraste entre l'ombre et la
clarté dépasse plusieurs dizaines de magnitudes. Essayez plutôt
d'effectuer une mise au point optimale durant la totalité, c'est
déjà toute une prouesse si vous disposez d'un réglage manuel, et
ensuite montrez votre savoir-faire en trouvant la meilleure exposition
qui fera ressortir tous les détails de la surface lunaire et toute la
richesse des tonalités rouges-orangées. La technique HDR est bien
sûr la solution idéale pour enregistrer toute la dynamique du
phénomène mais elle exige plus de travail lors du traitement d'image.
Le
phénomène étant relativement fugace, à l'ère des APN et autres
CCD, il va sans dire que vous avez intérêt à mitrailler pour
choisir ensuite les meilleurs photos que vous traiterez sur
ordinateur. En effet, après la prise de vue, vous n'avez encore accompli que la moitié
du travail ! Comme tout bon photographe vous devez ensuite corriger
vos images sur ordinateur (éventuellement après numérisation si
vous travaillez encore avec les rares films inversibles exitants) :
correction de gamma, masque flou, empilement, compositage, photomontage,
etc) pour obtenir des documents comparables à ceux présentés sur cette page.
Vous
pouvez aussi filmer le phénomène ou réaliser des photos espacées
de quelques secondes seulement. L'avantage est que cela vous permettra
d'empiler les meilleurs images parmi toutes celles enregistrées afin
de diminuer le bruit électronique et accentuer les détails.
Objet
de contemplation, les éclipses reflètent fidèlement les lois de la mécanique
céleste. Nous connaissons aujourd’hui les moindres faits et gestes de
la Lune. Nous ignorons l’ensemble de ses effets, mais ses influences
n’ont plus rien d’occulte et son action sur les êtres vivants est
loin d’être démontrée. Seuls effets sensibles, sa force gravitationnelle
qui induit les phénomènes de marées sur Terre et les nombreuses perturbations
orbitales citées précédemment.
Pour plus d'informations
Sur
ce site
Ephemerides
Les
éclipses solaires
La
photographie numérique
Formulaire
pratique
Bagues
T et tubes allonges
Les
appareils photos numériques en astrophotographie
Sur
Internet
How
to Photograph a Lunar Eclipse, Nikon/Fred Espenak
MrEclipse, Fred Espenak
Eclipse
(éphémérides) NASA-GSFC
Shadow and Substance (éphémérides et
simulations), Larry Koehn
Les
éphémérides astronomiques, Jean Vallières
Bureau
des Longitudes (éphémérides)
More
Mathematical Astronomy Morsels, Jean Meeus, Willmann-Bell, 2002.
Retour
aux Sciences du ciel
Retour
sur la Lune
|