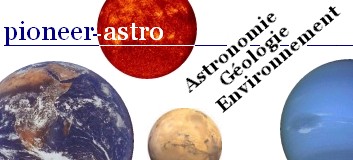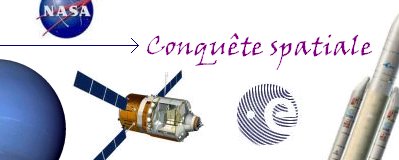| Découvrez toutes les rubriques du site : Page d'accueil Actualité du ciel Système solaire Univers (C) Conquête spatiale Environnement Biographies Liens Jeux Dictionnaire
Exprimez-vous !
Des questions ou
des problèmes ? Les articles sur la
navette spatiale dans l'actualité : Historique des
missions de la navette spatiale :
Zoom : explorez le système solaire ! |
La navette spatiale
américaine - Missions de
1991 [ << - STS-37 - STS-39 - STS-40 - STS-43 - STS-48 - STS-44 - >> ] STS-37 (Atlantis)
Écusson Le satellite GRO (Gamma Ray Observatory) s'éloigne de l'orbiteur Atlantis. Les traînées tricolores derrière les deux engins forment la lettre grecque gamma, en référence aux rayons étudiés par GRO. Dix étoiles sont dessinées sur cet écusson : elles sont réparties en un groupe de 3 et un autre de 7 pour symboliser le numéro de la mission. Les États-Unis sont visibles à travers les nuages. Généralités
Objectifs Le principal objectif de ce vol est de lancer le satellite GRO (Gamma Ray Observatory) qui, comme son nom l'indique, est sensible aux rayons gamma. En outre, une sortie dans l'espace est aussi au programme de la mission. Confiée à Jerry Ross et Jay Apt, elle a pour but de tester le CETA (Crew and Equipment Translation Aids), une sorte de chariot permettant de déplacer aisément des astronautes ou du matériel. Le CETA doit à terme équiper la future station spatiale Freedom. De plus, plusieurs expériences scientifiques sont embarquées sur Atlantis. L'une d'entre elles, baptisée Sarex 2 (Shuttle Amateur Radio Experiment 2), consiste à établir des communications avec des radioamateurs. Enfin, l'US Air Force doit encore utiliser la navette spatiale pour calibrer ses instruments de suivi installés à Hawaii. Déroulement La navette spatiale Atlantis décolle le 5 avril 1991 à 14h22 TU. Le lancement, prévu quatre minutes plus tôt, a été légèrement repoussé à cause de la couverture nuageuse située au-dessus du Kennedy Space Center. Le satellite GRO (Gamma Ray Observatory) est extrait de la soute à l'aide du bras canadien RMS (Remote Manipulator System) lors du troisième jour de vol. Malheureusement, son antenne à haut gain refuse de déployer. Une sortie extravéhiculaire est alors improvisée par la Nasa pour résoudre ce problème. Elle est effectuée par Jerry Ross et Jay Apt qui parviennent à déployer manuellement l'antenne réticente. Le lendemain, les deux astronautes quittent à nouveau l'orbiteur afin de tester le chariot CETA (Crew and Equipment Translation Aids). Cette seconde sortie dure un peu moins de six heures. Le retour sur Terre, prévu pour le 10 avril, est reporté d'une journée à cause des conditions météorologiques défavorables constatées à la base d'Edwards et à Cap Canaveral. Atlantis ne se pose donc que le 11, à 13h55 TU, en Californie. Elle est ensuite ramenée au Kennedy Space Center le 18. Équipage
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-39 (Discovery)
Écusson Les sept étoiles visibles en arrière-plan représentent les sept astronautes de la mission. De plus, elles forment la constellation de l'Aigle (cet animal est un symbole des États-Unis). Altaïr, l'étoile la plus brillante, envoie vers la Terre des rayons aux couleurs du drapeau américain. La forme de flèche de l'écusson montre que le programme STS est synonyme d'avancées scientifiques et technologiques. Généralités
Objectifs La mission STS-39 est dédiée au DoD (Department of Defense) mais, pour une fois, toute la cargaison n'est pas confidentielle. On sait ainsi que les charges utiles suivantes se trouvent dans la soute Discovery : AFP 675 (Air Force Program 675), STP 1 (Space Test Payload 1) et IBSS (Infrared Background Signature Survey). Elles sont toutes les trois financées par l'armée américaine dans le cadre de la Strategic Defense Initiative, le fameux projet 'Guerre des Étoiles'. L'expérience IBSS est composée de trois éléments, dont un monté sur la plate-forme Spas 2 (Shuttle Pallet Satellite 2), destinée à être déployée puis récupérée après quelques jours hors de l'orbiteur. Par ailleurs, deux expériences sont placées dans la cabine de l'équipage : RME 3 (Radiation Monitoring Equipment 3) et Clouds 1 (Cloud Logic to Optimize Use of Defense Systems 1). De plus, la navette emporte une expérience militaire confidentielle installée à l'intérieur d'un caisson spécial baptisé MPEC (Multi-Purpose Experiment Canister) situé dans la soute. Déroulement Initialement programmé le 9 mars 1991, le lancement n'a lieu finalement que le 28 avril. En effet, alors que la navette se trouve sur le pas de tir 39A du Kennedy Space Center, des fissures sont détectées sur des éléments reliant l'orbiteur et le réservoir externe. Par conséquent, Discovery est renvoyée au VAB (Vehicle Assembly Building), où son réservoir externe et ses deux boosters sont démontés. Elle est ensuite amenée à l'OPF (Orbiter Processing Facility) pour effectuer les réparations. Les pièces défectueuses sont remplacées par d'autres provenant de l'orbiteur Columbia. La navette Discovery est de retour sur le pas de tir 39A le 1er avril et la date du décollage est fixée au 23. Mais un nouveau problème est mis en évidence : un capteur situé sur le moteur principal n°3 donne des indications erronées et doit de ce fait être remplacé. Le 28 avril 1991, donc, la douzième mission de Discovery débute. Les diverses expériences présentées dans le paragraphe précédent sont menées par les sept astronautes. La plate-forme Spas 2, qui supporte un des éléments de l'IBSS (Infrared Background Signature Survey), est larguée puis récupérée sans problème à l'aide du bras RMS. L'atterrissage est détourné vers le Kennedy Space Center à cause des vents violents qui balayent la base d'Edwards. Le 6 mai, Discovery se pose donc en Floride, après plus de 8 jours de vol. Équipage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-40 (Columbia)
Écusson Le célèbre 'homme de Vitruve' dessiné par Léonard de Vinci figure sur cet écusson : il a un pied sur Terre et un autre au contact d'une étoile. De plus, ses mains touchent la trajectoire de Columbia afin de montrer que la navette permet à l'humanité d'explorer l'espace. La présence de cet homme met aussi en évidence les expériences sur la physiologie humaine qui seront menées au cours de ce vol. Les sept étoiles représentent les sept astronautes. Le Soleil levant indique que cette mission va permettre de réaliser de nombreuses découvertes. Généralités
Objectifs La mission STS-40 est la cinquième à emporter le Spacelab. Elle est intitulée 'Spacelab Life Sciences 1' car les dix-huit expériences placées à l'intérieur du laboratoire conçu par l'Esa sont consacrées aux sciences de la vie. L'une d'entre elles s'intéresse à de minuscules méduses, sept autres concernent des rongeurs et les dix dernières ont pour cobayes les astronautes eux-mêmes. De plus, d'autres expériences sont installées dans des caissons baptisés GAS (Get Away Special) et situés dans la soute de l'orbiteur : elles s'intéressent aux sciences des matériaux, à la biologie végétale et aux radiations cosmiques. Enfin, on trouve aussi à bord de Columbia sept OEX (Orbiter Experiments) et l'expérience M0DE (Middeck Zero-Gravity Dynamics Experiment). Déroulement Le 20 mai 1991, alors que le vol STS-40 doit débuter dans un peu moins de deux jours, la Nasa reporte le lancement de Columbia. Et pour cause : l'agence spatiale américaine vient d'apprendre qu'un test effectué par le constructeur du système de propulsion de l'orbiteur a mis en évidence la fragilité de certaines pièces de celui-ci. Les ingénieurs craignent que plusieurs de ces pièces cèdent et soient aspirées par les turbopompes, ce qui pourrait causer une défaillance des moteurs. Les pièces incriminées doivent donc être remplacées. En plus de cela, la navette subit une importante panne informatique. Le décollage est programmé pour le 1er juin, le temps d'effectuer toutes les réparations nécessaires. Mais un nouveau problème, concernant une unité d'alignement inertiel, retard le lancement de quelques jours. Finalement, le 5 juin 1991 à 13h24 TU, Columbia s'envole du Kennedy Space Center. Les neuf jours de vol permettent de mener à bien les très nombreuses expériences embarquées. C'est la première fois depuis les missions Skylab que des recherches aussi précises sont effectuées en physiologie humaine. Les expériences portent notamment sur le cœur, les poumons, les reins, le sang, le système immunitaire, les muscles, le squelette et le système nerveux. Le 14 juin, à 15h39 TU, les roues de Columbia touchent la piste 22 de la base de l'US Air Force à Edwards : elles y parcourent 2 866 mètres en 55 secondes avant de s'immobiliser. Équipage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-43 (Atlantis)
Écusson Pour commémorer le trentième anniversaire du premier vol habité américain (effectué par Alan Shepard le 5 mai 1961), l'écusson a la forme d'une capsule Mercury. La navette Atlantis est superposée à cette dernière pour montrer que le programme STS s'appuie sur l'expérience acquise avec ses prédécesseurs (Mercury, Gemini et Apollo). Les portes de la soute sont ouvertes et le satellite TDRS 5 quitte l'orbiteur. Le numéro du vol est symbolisé par un groupe de quatre étoiles et un autre de trois en haut de l'écusson. Généralités
Objectifs La principale charge utile emportée par Atlantis est le satellite TDRS 5 (Tracking and Data Relay Satellite 5). Celui-ci est équipé d'un IUS (Inertial Upper Stage), un système propulsif destiné à lui permettre de gagner son orbite géosynchrone après avoir quitté la soute de l'orbiteur. Les autres charges utiles placées à bord de la navette sont des expériences concernant différentes disciplines scientifiques telles que l'astronomie (étude du rayonnement ultraviolet solaire), la physique atmosphérique (observation des aurores polaires), la biologie (étude des protéines), etc. Enfin, l'US Air Force doit une nouvelle fois utiliser la navette pour calibrer des instruments de suivi installés à Hawaii : c'est l'expérience Amos (Air Force Maui Optical Site). Déroulement A l'origine, le lancement de la mission STS-43 est programmé pour le 23 juillet. Mais il est repoussé une première fois pour remplacer un composant électronique défaillant qui contrôle le largage du réservoir externe. Le lendemain, hélas, le décollage est à nouveau reporté à cause d'un problème concernant le moteur principal n°3. Le 1er août, une chute de pression dans la cabine de l'équipage ainsi que des conditions météorologiques défavorables conduisent la Nasa à décaler le tir d'un jour. Le 2 août, donc, Atlantis et ses cinq passagers quittent le pas de tir 39A du Kennedy Space Center à destination de l'espace. Le satellite TDRS 5 (Tracking and Data Relay Satellite 5) est déployé après environ six heures de vol. L'opération se déroule sans encombre. Un peu plus tard, l'IUS (Inertial Upper Stage) s'allume pour envoyer l'engin vers son orbite définitive. Le reste de la mission est consacré à la réalisation des nombreuses expériences scientifiques décrites dans le paragraphe précédent. Pour la première fois depuis le vol STS-61C (en janvier 1986), l'atterrissage est prévu au Kennedy Space Center. C'est donc en Floride que la navette Atlantis se pose le 11 août à 12h23 TU. Équipage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-48 (Discovery)
Écusson L'écusson de la mission STS-48 montre Discovery après le déploiement du satellite UARS (Upper Atmosphere Research Satellite), qui est symbolisé en haut de l'écusson par de grosses lettres munies d'un panneau solaire. L'atmosphère terrestre est représentée par trois bandes colorées. Seules les deux du dessus sont déviées vers UARS pour expliquer que celui-ci est consacré à l'étude de la haute atmosphère. Généralités
Objectifs Pour son treizième vol, Discovery est chargée de mettre sur orbite le satellite UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) qui doit, pendant au moins 18 mois, étudier la haute atmosphère terrestre grâce à ses dix instruments de mesure. En outre, plusieurs expériences scientifiques sont présentes à bord de la navette. L'une d'entre elles, baptisée Cream (Cosmic Ray Effects and Activation Monitor), étudie les effets des rayons cosmiques. Une autre, appelée Pare (Physiological and Anatomical Rodent Experiment), s'intéresse à la physiologie et à l'anatomie des rongeurs. Enfin, l'expérience Amos de l'US Air Force (suivi de la navette par laser) est reconduite pour ce vol. Déroulement Le lancement du vol STS-48 a lieu le 12 septembre 1991 à 23h11 TU, après un léger retard (14 minutes) causé par un problème de communication entre le Kennedy Space Center et le Mission Control Center situé à Houston (Texas). Discovery se satellise d'abord à une altitude d'environ 540 km puis grimpe ensuite progressivement jusqu'à 580 km. L'observatoire UARS est déployé avec succès au cours du troisième jour de vol. Les astronautes doivent aussi mener à bien les multiples expériences scientifiques embarquées. L'atterrissage ne peut avoir lieu à Cap Canaveral à cause des mauvaises conditions météorologiques qui y règnent. Par conséquent, il est détourné vers la Californie et c'est donc sur la piste 22 de la base d'Edwards que l'orbiteur se pose le 18 septembre à 7h38 TU, avant d'être ramené au Kennedy Space Center le 26. Équipage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS-44 (Atlantis)
Écusson Atlantis vient de décoller. Le drapeau américain montre que, grâce à la navette, les États-Unis sont omniprésents dans l'espace. Dans le ciel, on voit six étoiles très brillantes et d'autres moins visibles. Les premières représentent les astronautes de la mission et les secondes toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre mais sans lesquelles les vols habités ne seraient pas possibles. Généralités
Objectifs Ce vol est dédié au Department of Defense (DoD), le ministère de la Défense américain. Cependant, comme pour le précédent (STS-39 avec Discovery en avril-mai 1991), tout n'est pas confidentiel. On sait ainsi que cette mission a pour objectif principal de lancer le satellite d'alerte avancé DSP 16 (Defense Support Program 16). Ce dernier est attaché à un IUS (Inertial Upper Stage). En outre, de très nombreuses expériences sont installées dans la soute et dans la cabine de l'équipage. On retrouve par exemple l'expérience Cream (Cosmic Ray Effects and Activation Monitor), présente lors de la mission STS-48. L'expérience 'Military Man in Space' est confiée à l'astronaute militaire Thomas Hennen, qui occupe le poste de 'spécialiste de charge utile'. Enfin, la navette doit être suivi par laser dans le cadre de l'expérience Amos de l'US Air Force . Déroulement Un problème concernant l'IUS (Inertial Upper Stage) du satellite DSP 16 oblige la Nasa à repousser de quelques jours le décollage de la navette Atlantis. Celui-ci a donc lieu le 24 novembre et non le 19 comme prévu. Le jour J, un report de 13 minutes s'avère nécessaire pour, d'une part, laisser passer un engin en orbite et, d'autre part, procéder au remplissage du réservoir d'oxygène liquide qui a été retardé par une défaillance d'une valve dans le système de remplissage. A 23h44 TU, Atlantis s'envole enfin. Après la mise en orbite, les six astronautes se mettent au travail. Le satellite DSP 16 est déployé dés le premier jour de vol. Son IUS lui permettra par la suite d'atteindre son orbite définitive. Les jours suivants sont entièrement consacrées aux expériences. La mission est hélas écourtée à cause d'une panne d'une des trois unités d'alignement inertiel. La navette se pose donc le 1er décembre sur la base d'Edwards au lieu du 4 à Cap Canaveral. Lors de l'atterrissage, un test de faible freinage est réalisé. Cela explique la grande distance parcourue par Atlantis avant de s'arrêter : 3,4 km contre environ 2,8 habituellement. Ce test a pour but d'évaluer la distance nécessaire pour faire atterrir un orbiteur dont les freins seraient endommagés. Équipage
[ Haut de la page ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous êtes ici : La page d'accueil > La conquête spatiale > La navette [...] - Missions de 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||