|
L'analemme
du Soleil
Texte
et illustrations d'Anthony AYIOMAMITIS
Notes
sur la prise de vue (II)
Les
points de théorie “critiques” à présent résolus il est temps de s’intéresser
à la prise de vue, au type de film à utiliser en conjonction avec un
filtre solaire et l’objectif photographique adéquat. Mon filtre solaire
est un filtre Mylar Baader ND5 transmettant un cent millième de la
lumière solaire. Un calcul simple permet de déduire que le temps d’exposition
doit être de 1/500e de seconde à f/11 sur un film couleur de 200
ISO (par exemple sur le Fuji Super HQ 200).
Afin de compenser l’exposition pour les jours durant lesquels il pourrait y
avoir de la brume ou un ciel couvert, durant l’hiver lorsque le Soleil
est bas sur l’horizon ou lorsqu'il n'est pas assez brillant suite à des
effets atmosphériques, j’ai décidé de surexposer chaque image de 3
stops et d'utiliser une vitesse d'obturation de 1/60e de seconde.
J’ai
découpé un rectangle de 60 mm x 60 mm dans une feuille de Mylar que j’ai
insérée entre le filetage du filtre porte-objectif de mon grand angle et
le filtre UV de 52 mm de diamètre. Le filtre a ensuite été vissé
prudemment sur l’objectif sans trop froisser le filtre solaire. Il faut
également savoir que le fait de froisser légèrement le film Mylar ou le
fait que sa surface ne soit pas totalement plane n’a aucun effet sur la
qualité de l’image.
A
télécharger : Exposure
Calculator
Un
programme de Michael A. Covington
Une
série de photographies ont ensuite été prises pour m’assurer qu’aucune
lumière parasite ne venait éventuellement frapper directement l’objectif
et que l’exposition choisie était bien adaptée à la photographie du
disque solaire, sans le surexposer.
Enfin,
il fallut considérer la stabilité du boîtier photographique et de sa
monture. Plutôt que de risquer une chute accidentelle d'un trépied au
cours des douze mois que durera le projet (il y au moins 43 chances qu’un
tel accident survienne), j’ai construit une monture en bois constituée
de deux pièces qui s'épousent parfaitement et adaptées aux réflex
Canon AE-1 et A-1 car il était impossible de laisser ces appareils
photographiques en permanence à l’extérieure en raison des
intempéries (pluie et hiver) (voir photographies ci-dessous).
La
première partie de la monture est constituée de bois aggloméré et est
fixée solidement à demeure à l’extérieur avec des vis de serrage de
charpentier, l’ensemble étant protégé des intempéries avec des sacs
de 20 kg de nourriture pour chiens (!) pour éviter toute dégradation du
bois par l’humidité et la pluie, ce qui ruinerait l’orientation du
système.
Voici
l'aspect de la batterie de 7 boîtiers réflex utilisés et du support de bois constitué
de deux parties :
La
seconde partie de la monture est attachée en permanence au boîtier
réflex – en badigonneant de la colle silicone entre le dos de l’appareil
photo et le support vertical en bois ainsi qu’entre la base du boîtier
et la monture – l’appareil et son support se posant et coulissant
très doucement sur la base laminée fixée à demeure à l’extérieur.
Un trou de 25 mm a été foré dans le support permanent du réflex Canon
AE-1 juste sous le bouton de rebobinage du film afin de réaliser
manuellement les prises de vue multiples de ce projet. Enfin, tous les
quatre mois j’ai ajouté un peu de colle silicone pour renforcer la
fixation entre le boîtier réflex et la monture.
Le
déclenchement de l’oburateur s’effectua à 06h00m00s TU précise.
Cette image comme toutes les autres fut précédée par un contrôle
manuel d’une horloge atomique, un "time server" situé auprès
de l’US National Institute of Standards and Technology (NIST)
grâce au logiciel (gratuit) “Atomic
Clock Sync V2.0”. L'heure précise peut également être obtenue en
écoutant certaines fréquences ondes-courtes
dédicacées à ce service.
Connectez-vous
aux Time Servers :
BIPM
(France) - NIST
(USA) - L'heure dans n'importe
quelle ville - ClockLink
Cette
mesure s'effectua dix minutes avant la prise de vue afin de calibrer mon
système avec le temps atomique définit par le NIST de manière à
obtenir une précision horaire de l’ordre de +0.5 seconde (car
même une déviation de quelques secondes dans le temps, et spécialement
vers la fin de l’été se voit parfaitement dans l’analemme final).
Première
tentative marathon
Pour
éviter toute vibration j’ai vissé sur le bouton du déclencheur un
câble souple et j’ai équipé le boîtier du Canon AE-1 d’une
nouvelle batterie pour effectuer une première série de 11 images de l’analemme,
en commençant à 06h00m00s TU le jour du solstice d’été (21 juin
2001) pour terminer début juin 2002.
Alors
que je correspondais par courrier électronique avec Dennis di Cicco au
cours des premières semaines de prise de vue du premier analemme, j’ai
été agréablement surpris d’apprendre qu’un analemme parfaitement
vertical par rapport au méridien, correspondant depuis mon lieu d’observation
à une exposition à 10h28m16s TU précise, n’avait jamais été réalisé.
|
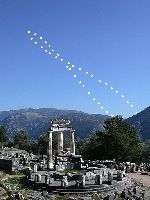
|
|
L'analemme
de 6h TU au-dessus du temple de Tholos,
l'ancienne Delphes. |
Etant
donné que le solstice d’été était légèrement dépassé, j’ai dû
déterminer l’époque à laquelle Mars se présentait exactement à
180° d’azimut (en plein sur le méridien sud) afin de calibrer l’emplacement
exact de l’appareil photographique et de sa monture par rapport à ce
point et pour éviter tout effet de distorsion avec l’objectif grand
angle ce qui me permettait d’anticiper plus facilement le cadrage de l’image
composite finale.
Une
fois ce travail terminé, un second analemme fut immédiatement réalisé
au moyen du second boîtier Canon A-1. Bien sûr l’avarice et
la détermination m’ont guidé tandis que quatre autres analemmes
(07h00m00s à 10h00m00s TU) ont été lancés peu de temps après ainsi
que l’objectif final qui consistait à réaliser un analemme complet
(photographié à une heure d’intervalle entre 06h00m00s et 15h00m00s
TU et à 10h28m16s TU précise pour le cas particulier du méridien).
Avec
six analemmes en cours de réalisation à la fin de l’été 2001 et la
rédaction de cet article durant plusieurs nuits, ce projet m’occupa
près d’une année non-stop mais il devait finalement me donner la
grande joie d’enregistrer le déplacement complet du Soleil entre son
lever et son coucher.
Avec
le temps tous les obstacles potentiels semblaient à présent être des
détails mineurs. Deux tremblements de terre (26 juillet 2001, Richter 5.7
et octobre 2001, Richter 5.2) n’ont eu aucun impact sur mes montures
fixées à demeure ou sur les analemmes en cours.
Mais
comme si la chance était avec moi, une période d’intempéries comme on
n’en avait plus connue depuis plus de dix ans s’abattit sur ma région
début novembre 2001, juste entre les périodes de photographies, où il
plut à verses durant quatre jours en provoquant des inondations sur le
versant de la montagne opposé au mien, me mettant heureusement à l’abri
de tout tracas, ce qui me permis de me concentrer sur les 11 analemmes
toujours en cours.
Toutefois
durant cette période j’ai réalisé a posteriori que j’aurai dû
construire mes montures permanentes en métal et ne pas utiliser du bois
aggloméré car exposé à ces fortes pluies, et malgré la haute couche
de protection dont je l’avais revêtu, le bois s'est déformé et je
devais fixer les boîtiers encore plus forts dans leur support pour
éviter qu’ils ne bougent. Mais en analysant les éphémérides durant
les quatre jours de pluie j’ai réalisé que l’impact aurait de toute
manière été négligeable même si j’avais dû postposer les prises de
vue de deux ou trois jours par rapport à la date prévue étant donné
que le mouvement journalier du Soleil dans le ciel au mois de novembre est
relativement “lent”. Toutefois durant ces quatre jours de tempête j’ai
perdu l’opportunité d’enregistrer une image multiple du disque
partiellement obscurcit du Soleil dans le dernier analemme (15h00m00s
TU) qui aurait pu me servir d’images de substitution pour les six images
réalisées des deux côtés de l’apex hivernal en raison de l’obstruction
physique provoquée par la montagne toute proche que je ne pouvais pas
éviter.
Les
conditions climatiques étaient potentiellement le facteur de risque le
plus grand à prendre en considération en raison des conséquences
désastreuses qu’un ciel couvert pouvait impliquer sur mon projet.
Nous y reviendrons dans la dernière page.
|
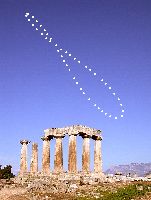
|
|
Analemme
de 7h TU au-dessus du temple d'Apollon, dans l'ancienne Corinthe. |
Aussi j’ai religieusement vérifié les prévisions météos un jour avant
chaque prise de vue ainsi que suffisamment tôt dans la journée
concernée afin d’avancer le cas échéant mes prises de vue d’une
journée dans l’éventualité ou surviendrait une période de pluie ou
un ciel couvert le jour venu voir le lendemain du jour considéré. Mais
je ne pouvais pas dévier ma série de photographies de + 1 jour en
raison de la symétrie qu’il fallait absolument conserver (verticalement
et horizontalement) dans les analemmes complets (la seule exception est
le point de croisement où aucune déviation n’est tolérée).
Alors
que mes deux premiers analemmes (06h00m00s TU et 10h28m16s TU) étaient
à moitié enregistrés, je fus contraint de dévier de ma sacrée règle
début décembre 2001. Je fus dans l'incapacité de réaliser des prises de vue durant
toute une journée et une pluie diluvienne accompagnée des plus fortes
chutes de neige comme jamais on en avait enregistrées depuis 39 ans m’empêchèrent
durant les deux semaines qui suivirent de photographier le Soleil à l’heure
prévue.
Ces
incidents provoquèrent beaucoup de “trous” indésirables juste avant l’apex
hivernal, constituant autant de signature caractéristiques de ces
analemmes en cours de réalisation (ils reflètent la fureur des dieux
grecs !).
Au
plus je pense à ces images multiples manquantes au plus je me dit que le
problème survînt pour la simple raison que j’ai voulu réaliser un
ensemble parfait d’analemmes du lever au coucher du Soleil.
En
vérifiant les prédictions météos pour l’exposition multiple
suivante, la période du solstice d’hiver du 21 décembre 2001 s’annonçait
avec une importante couverture nuageuse et je commençais à craindre le
pire. Avoir avoir eu la confirmation que le ciel serait couvert toute la
matinée du solstice d’hiver, j’ai officiellement accepté mon destin
et pris l’humble décision de recommencer tous les analemmes et de
renoncer à la centaine d’expositions multiples réalisées jusqu’à
alors.
A
cet effet, début janvier 2002 et bénéficiant d’un ciel parfaitement
serein, j’ai recommencé les onze analemmes de manière à couvrir une
année calendrier complète, une caractéristique qui ne figure dans aucun des analemmes
réalisés jusqu’à ce jour (l’analemme de HJP
Arnold décrite par di Cicco était proche de l’année calendrier
puisqu’il fut réalisé entre janvier 1988 et janvier 1989). Bien
que très déçu de devoir renoncer à autant de travail et d'avoir perdu
tout ce temps, j’ai donc décalé les analemmes complets de six mois
(en considérant qu’il n’y aurait plus d’évènements compromettant
à l’avenir), en prenant le risque que le premier analemme
parfaitement vertical pris au méridien soit réalisé par quelqu’un
d’autre plus chanceux que moi. J’ai donc à nouveau lancé les dés
pour les douze mois à venir, cette décision offrant l’avantage de me
permettre de commencer et de terminer tous les analemmes à la même
date ainsi que de représenter le mouvement du Soleil à travers le ciel
durant exactement une année calendrier.
J’ai
donc réfréné mon désir de poursuivre les expositions multiples et j’ai
simplement attendu que les mois passent jusqu’au 3 et 21 décembre 2002,
dates auxquelles j’ai pu heureusement rephotographier les images
manquantes pour couvrir les jours qui n’avaient pas pu être
enregistrés au cours des douze mois précédents.
De
la même manière, j’ai sciemment sauté les images du 12 janvier 2002
afin de rétablir la symétrie horizontale. Mais cette fois en perdant
deux images par analemme, bien que la solution paraisse appropriée, elle
ne fut pas judicieuse car la symétrie verticale avait déjà été
affectée par les images manquantes du 3 décembre 2001 et elles ne
pouvaient pas être récupérées.
Prochain chapitre
Deuxième
tentative marathon
|