|
L'analemme du Soleil
|
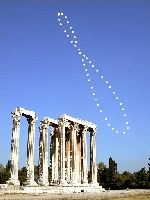
|
|
L'analemme
de 10h TU au-dessus du temple de Zeus, à Athènes. |
Texte
et illustrations d'Anthony AYIOMAMITIS
Les
problèmes et leurs solutions (IV)
Initialement,
mes idées concernant les problèmes potentiels qui pouvaient survenir et
leurs solutions ont porté sur la météo. J’ai toujours eu le sentiment
que le ciel de Grèce était suffisamment clair et stable pour oser
défier les trop célèbres ciels noirs du désert d’Arizona et c’est
un facteur que j’ai à nouveau formellement confirmé tout au long de ce
projet qui s’étendit sur pratiquement deux ans (voir Table
3).
Mais
j’ai bientôt découvert que mon véritable défi résidait dans l’avance
automatique mais accidentelle du film qui, de manière répétée, ruina un
certain nombre de mes analemmes (heureusement cela se produisit durant la
première tentative me forçant à recommencer près de trois mois plus
tard que la date que je m’étais fixée). Une
condition et un objectif clés de cet exercice qui s'étendit sur plus de 12 mois
furent de déterminer les valeurs reprises dans le tableau 14 à partir des
analemmes actuelles – en lieu et place des valeurs théoriques
publiées dans l’article de di Cicco[2].
J’ai
donc voulu utiliser non seulement le même objectif réflex (24 mm
f/2.8 Canon FD) pour l’ensemble des 473 surimpressions (11
analemmes contenant chacun 43 images) mais également les mêmes
boîtiers compatibles avec cette optique.
Les
deux réflex Canon A-1 disposent d’un bouton spécial pour les
surimpressions (expositions multiples) qui facilite l’exercice.
Par contre les réflex Canon AE-1 qui sont
également tout à fait compatibles avec les optiques FD ne disposent pas
de cette fonction et le photographe intéressé par cette fonctionnalité
doit user d’une méthode peu orthodoxe pour y parvenir en rebobinant le
film et le faisant à nouveau avancer pour activer le déclencheur.
Certains
dos du Canon AE-1 présentent assez de friction mécanique pour déplacer
légèrement le film même lorsque le bouton de rebobinage a été
enfoncé – une fois que le film se
déplace, et même légèrement, le bouton de rebobinage revient en
arrière et réengage l’avancement du film, rendant la méthode de
retour en arrière inutile. Malheureusement c’est cet infortuné
scénario qui a ruiné de manière répétée plusieurs de mes analemmes
durant les 2 ou 3 premiers mois de ce projet. Pour les trois “problèmes”
rencontrés avec les Canon AE-1, je découvris bientôt que je devais
fermement maintenir dans sa position le bouton de rebobinage situé à la
base du boîtier en utilisant un petit tournevis à tête plate pendant
que j’avançais le levier du film d’une image. Avec le quatrième
boîtier Canon AE-1, à une occasion le 26 septembre 2001 (analemme de
09h00m00s-10h00m00s TU) j’ai été surpris d’avoir totalement oublié
ce modus operandi, ce qui ruina un autre double analemme en cours,
perdant ainsi l’équivalent de quatre semaines d’imagerie.
Au
boîtier Canon AE-1 qui me posa le plus de problèmes j’assignai par la
suite la tâche de réaliser un seul analemme (15h00m00s TU) en
réduisant le nombre d’expositions multiples de 86 (double analemme) à
43 (analemme simple).
|

|
|
L'analemme
de 10h28m16s TU au-dessus du Parthénon d'Athènes. |
Toutefois j’ai dû
recommencer à cinq reprises les prises de vues réalisées au moyen de ce boîtier; à la cinquième et
dernière tentative j’ai décidé de mettre ce réflex en retraite
anticipée et je l’ai personnellement expédié sur orbite[3]
en profitant de l’occasion pour le remplacer par un nouveau modèle,
cette succession d’évènements clôturant définitivement cette “tragédie
grecque” sans fin.
Avoir
avoir connu de fréquents départs avortés impliquant tous mes nouveaux
boîtiers Canon AE-1 et après avoir perdu suffisamment d’images
multiples rassemblant globalement l’équivalent de trois analemmes, j’ai
préparé une check-list (Table
4) afin d’éliminer autant que possible tout retard futur ou
accident potentiel.
Au
lecteur intéressé par la réalisation des analemmes au moyen de réflex
Canon de la série A je conseille vivement de choisir le boîtier A-1
puisqu’il dispose en standard d’une fonction de surimpression qui est
vraiment adaptée à ce projet. Par comparaison, les cinq Canon AE-1 que j’ai
utilisés m’ont tous contraints à recommencer au moins deux fois les
analemmes en raison des défaillances qu’ils présentaient en utilisant
la manière peu orthodoxe de réaliser les surimpressions comme je l’ai
décrit un peu plus haut.
Cela
m’a rappelé avec peine une des histoires classiques de la mythologie
grecque dans laquelle Hadès punis Sisyphe en l’obligeant à rouler une
grosse pierre en haut d’une montagne et en la laissant rouler sur l’autre
versant une fois arrivé au sommet; Sisyphe fut condamné à refaire ce
travail pour l’éternité !
Cela
dit, mon coeur s’arrêtait presque de battre chaque fois que je dû
enclencher le levier d’avancement du film sur mes différents boîtiers
Canon A-1 et AE-1 car la moindre avance accidentelle aurait provoqué la
perte de l’analemme complet (ou de plusieurs d’entre eux si j’avais
enregistré plusieurs analemmes sur une même image) rendant tout le
travail accompli sans plus aucun intérêt ! Bien sûr cette arythmie
cardiaque s’accentua et alla de pire en pire à mesure que les analemmes
progressaient entre les avances accidentelles du film.
|

|
|
Analemme de
11h TU au-dessus d'Athènes.
|
Concernant
le champ photographié par l’objectif grand-angulaire de 24mm f/2.8 Canon
FD (couvrant 53° x 74° en mode paysage), son étendue est telle qu’il
fut possible de tenter de photographier deux analemmes sur la même image.
Il fallut pour cela placer précisément la monture permanente vis-à-vis
de ses repères en azimut et porter une grande attention à l’élévation
du boîtier photo ce qui constitua un exercice très difficile qui laissa
peu de place à l’erreur. A partir des chiffres repris dans la Table
1, la tolérance en élévation pour le double analemme réalisé à
09h00m00s-10h00m00s TU (élévation de 48.8°) est telle que l’erreur
est inférieure à 10% ou, pratiquement, inférieure à 5% dans les deux
directions.
Cette
tolérance était encore plus faible pour le double analemme réalisé à
11h00m00s-12h00m00s TU pour lequel la variation
en élévation fut de 49.3°. Une bénédiction sous-jacente fut de
découvrir que si une erreur se produisait dans l’installation physique
à proprement dit des appareils photos et/ou dans le positionnement de la
monture par rapport respectivement à l’élévation et l’azimut, un
analemme complet pouvait encore être réalisé une fois l’exercice
terminé.
Mis
à part un boîtier réflex capable de réaliser des surimpressions, un
objectif grand-angle et un câble souple de déclenchement pour éviter
les vibrations, je vous conseille d’utiliser un viseur à angle droit
(tel que le Canon Angle Finder B) pour faciliter le cadrage des analemmes
(surtout lorsque aucune erreur n’est tolérée comme c’est le cas avec
les analemmes doubles) et pour surveiller l’évolution de la prise de
vue car pour cinq des onze analemmes réalisés durant l’année, la
déclinaison maximale du Soleil dépassait 65° d’élévation et il
aurait été impossible d’observer l’image à travers le viseur sans
cet accessoire bien commode.
|
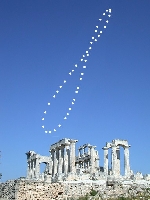
|
|
Annalemme
de 12h TU au-dessus du temple de Aphaia (490-480 avant notre
ère), Athènes. |
Un
point que nous n'avons pas évoqué mais qui parut évident après coup
est le fait que la cordelette qui est attachée au boîtier se balade
librement lorsque vous avez l’appareil en main. Ces “straps” sont
fixées à des crochets solidaire du boîtier et elles finissent par
endommager les points de fixation permanents que vous avez repérés et
fixés avec de la colle silicone. Ceci ne se produisit non pas une fois
mais deux fois durant là première tentative marathon et je résolus le
problème durant la seconde tentative en retirant purement et simplement
les cordelettes de leurs attaches. A une occasion l’accrochage des
straps fut tellement bien ancré dans une appendice un peu trop apparente
que le boîtier réflex fut complètement délogé de la monture dans
laquelle il était a priori solidement maintenu (une autre reprise à
zéro !). Pour éviter tout problème retirez donc la cordelette des boîtiers
réflex.
Une
considération subtile qui mérite d’être mentionnée est le changement
d’heure au printemps et en automne lorsque les montres et horloges
doivent être ajustées à l’heure d’été ou d’hiver, les avançant
ou les reculant respectivement d’une heure. J’ai (presque) toujours
travaillé en TU durant les 21 mois qu’a duré cet exercice afin
d’éviter toute confusion et, plus important, de devoir recommencer mes
prises de vues. Toutefois, cela ne m’a pas évité fin avril 2002 de
photographier les analemmes de 06h00m00s TU et de 07h00m00s TU une heure
plus tôt que prévu pensant que je travaillais en heure locale comme s’était
encore le cas quelques semaines plus tôt.
Le
même incident survint à nouveau mi-octobre 2002 quand l’analemme de
09h00m00s TU fut réalisé avec le boîtier de l’analemme de 08h00m00s
TU suite à cette même confusion. Ces
trois images du Soleil ont été corrigées par traitement numérique et,
heureusement, cet incident n’a pas eu d’effet négatif sur les images
finales des analemmes sur lesquels les disques solaires auraient pu se
superposer. Les analemmes de 07h00m00s et 08h00m00s TU ont toutefois été
recommencés en 2003 et ce sont ces derniers qui sont présentés sur
cette page.
Dernier
chapitre
Le
facteur météo
|